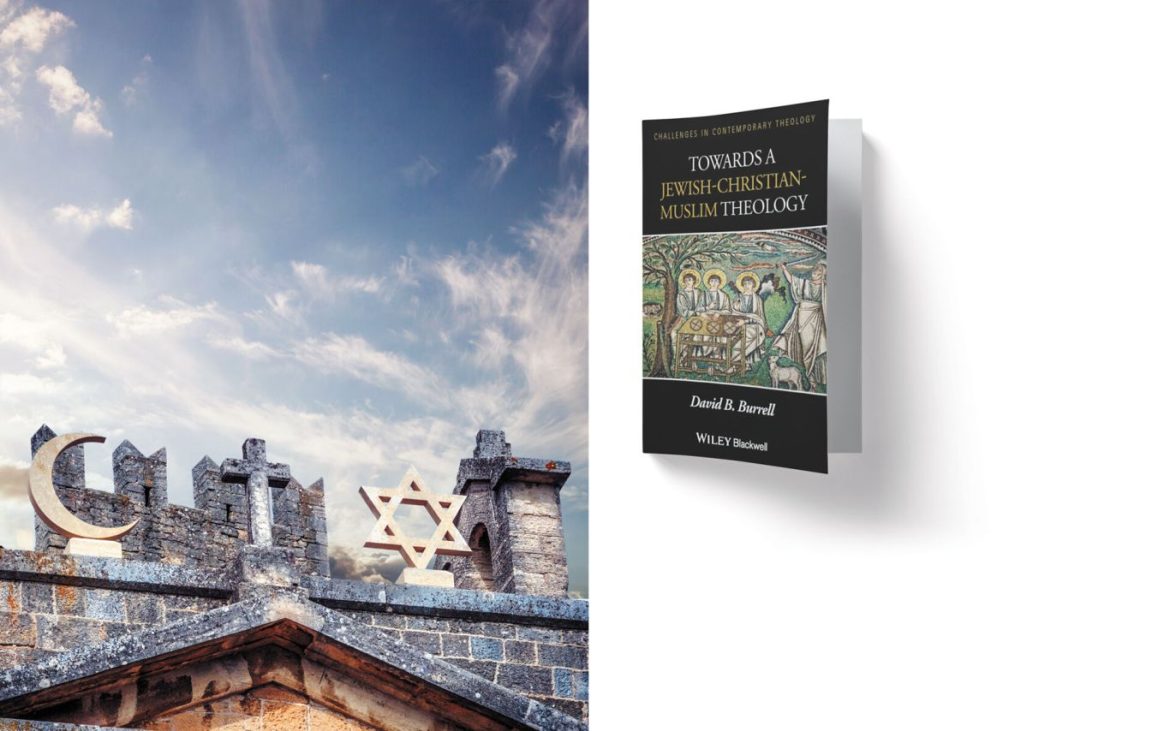La connaissance indéniablement profonde de Burrell
On pourrait suggérer que le travail de Burrell, aussi perspicace soit-il, pourrait révéler un excédent encore plus grand de significations sous-jacentes aux trois traditions s’il mettait en œuvre une approche plus systématique.
Dans cet article
-Le livre de Burrell met en œuvre ce qu’il appelle une « herméneutique créative » : il explore des « similarités-dans-différences » éclairantes au sein des schémas conceptuels développés par chaque tradition.
-C’est la vie et les actes des figures notables de la foi qui nous permettent d’enraciner notre « cadre de référence» ou nos « points de repère » quant à ce qu’une doctrine systématique peut être lorsqu’elle est « incarnée » dans la vie réelle.
-Le discours de De Caussade offre un « parallèle remarquable » avec celui de Ghazali : la foi, tout en dépassant la conceptualisation, est confirmée dans une confiance inépuisable en l’action divine qui « opère à chaque instant et en toutes choses ».
Le document libérateur du Concile Vatican II, Nostra Aetate, a suscité un énorme intérêt pour l’interrogation interreligieuse. L’une des voix distinctives catholiques modernes appartient à David Burrell (né en 1933), théologien philosophique et professeur émérite au séminaire Moreau, Notre-Dame, Indiana. Son livre, Vers une théologie judéo-chrétienne-musulmane (Chichester : Wiley-Blackwell, 2011), cherche à contribuer au champ jeune et pourtant en constante expansion de la théologie comparée. En tentant audacieusement de comparer des termes théologiques aussi chargés que la création, la liberté de la volonté et la grâce, tels qu’exposés par les principaux penseurs médiévaux et modernes de chaque tradition abrahamique, le livre de Burrell met en œuvre ce qu’il appelle une « herméneutique créative » : il explore des « similarités-dans-différences » éclairantes au sein des schémas conceptuels développés par chaque tradition (xxii). En effet, pour Burrell, les Juifs, les chrétiens et les musulmans « adorent tous le même Dieu » (xi), chaque tradition développant les caractéristiques du divin de manière parallèle. Du point de vue méthodologique, Burrell adhère à l’importance accordée par le théologien luthérien post-libéral George Lindbeck à la primauté de la pratique des croyants sur leurs doctrines, considérant ces dernières comme des «précipitations » ou des « distillations » des premières (1). Burrell reconnaît également que le « ton » de son projet a été donné par le célèbre théologien catholique Bernard Lonergan, qui a une « sensibilité pour les développements intellectuels latents dans une tradition révélatrice » et qui invite à saisir les questions théologiques qui sous-tendent toutes les réponses doctrinales (xiv).
Dans le chapitre 1, « La création libre en tant que tâche partagée pour les Juifs, les chrétiens, les musulmans », Burrell montre comment chaque tradition a contribué à façonner le contexte global dans lequel la doctrine de la création a été élaborée (11). Chacune partageait par exemple la croyance – aussi inimaginable que cela puisse paraître – que « la création ne peut être création que si Dieu peut être sans créer » (c’est-à-dire qu’Il peut exister sans le monde) (11, 13). Burrell mentionne également Ghazali, Maïmonide et Thomas d’Aquin comme des penseurs qui se ressemblent dans leur conception de la révélation en tant que correction de l’idée néo-platonicienne autrefois populaire selon laquelle la Création « émane » de Dieu de son propre consentement. Cependant, à un endroit, il semble que Burrell attribue à Thomas d’Aquin quelque chose que ni Thomas lui-même ni les néo-thomistes tels que J. Maritain ou B. Lonergan n’accepteraient : Thomas d’Aquin, malgré tout son soutien à l’idée de l’existence comme « acte » divin plutôt que « substance », peut difficilement être considéré comme « méprisant » l’idée que Dieu est « parfait » (21).
Le chapitre suivant, « Relier la liberté divine à la liberté humaine », montre à quel point les traditions islamique et chrétienne peuvent être ingénieuses lorsqu’il s’agit d’un jeu « à somme nulle » entre la liberté des humains et leur volonté autonome par rapport à l’omnipotence divine en tant que signifiant la subordination totale de la Création. Ghazali, par exemple, souligne que la question dépasse complètement la conceptualisation humaine, mettant plutôt l’accent sur l’importance de l’état spirituel de chacun (par opposition à la connaissance) en tant que capacité habituelle à aligner ses réponses personnelles à différents événements sur sa réalisation de l’omniprésence et de l’omnipotence divines (35-6). Burrell se réfère également à la conception de Thomas d’Aquin du « don libre » de la grâce divine – ce dernier dote la volonté d’une orientation incorporée et d’une « spécification » initiale vers le « bien complet » tout en ne prédestinant jamais le résultat de nos choix ; les humains sont considérés comme des « créateurs libres » de leurs actions uniquement lorsqu’ils refusent le don (37, 40). Burrell parle de la notion de « liberté située » – certes rhétorique – comme d’une position implicitement affirmée par les théologiens chrétiens et musulmans les plus courants. Selon cette notion, même si d’innombrables contraintes (« pressions ») et attractions (« sollicitations ») morales, politiques, sociales, économiques et autres informent constamment la chaîne et la trame de la vie de chacun, il reste encore de la place pour la discrétion personnelle et la préférence (37, 45).
Le chapitre 3, « Initiative humaine et grâce divine », démontre comment chaque tradition conçoit le divin non comme la « chose la plus importante qui soit » (ce qui équivaudrait à de l’idolâtrie) mais plutôt comme une « non-dualité » dans laquelle l’effet (la Création) peut subsister d’une manière qui ne détourne rien de la primauté ontologique de la cause (Dieu). Loin d’être un « Dieu déiste » distant, ce divin est à la fois identique à la Création (58-60) et en relation « interpersonnelle » avec la Création, que cette relation soit exprimée par la « grâce » (chrétiens), l’« alliance » (juifs) ou la « proximité de Dieu » (musulmans) (51-53). Cependant, Burrell ne montre pas si, et comment, cette « non-dualité » peut être défendue contre l’accusation possible de monisme ou de panthéisme.
Le chapitre 4, « Confiance en la Providence divine », approfondit – certes, de manière plus rhétorique que démonstrative – la question intraitable de la liberté des humains vis-à-vis de l’omnipotence et de la générosité de Dieu, en comparant cette fois les deux « œuvres clés du christianisme et de l’islam » : The Sacrament of the Present Moment du prêtre jésuite et professeur Jean-Pierre de Caussade et Faith in Divine Unity and Trust in Divine Providence de Ghazali. Pour Ghazali, on peut comprendre l’unité divine non pas par le biais de « schémas philosophiques », mais à travers une « vie de confiance » (tawakkul en arabe), où la pratique rigoureuse de la foi mène à la « seule compréhension possible ici », à savoir une vision mystique ou une « révélation » (kashf) (69). Le discours de De Caussade offre un « parallèle remarquable » avec celui de Ghazali : la foi, tout en dépassant la conceptualisation, est confirmée dans une confiance inépuisable en l’action divine qui « opère à chaque instant et en toutes choses » (76, 78). Cette confiance inébranlable ne cède guère à la résignation quiétiste : la « longue pratique » et la « parfaite compréhension de la musique » d’un musicien(ne) talentueux(se) lui permettent de créer de la musique « impromptue » de manière tout aussi impressionnante que de manière conventionnelle (78).
Le chapitre 5, « Le sens de tout cela : ‘Le Retour’, le Jugement et ‘La Seconde Venue’ », traite du retour de l’humanité, en réponse au don libre de la création, vers l’Un en tant que point de finalité ou perfection de l’humanité. C’est ainsi que la « seconde venue » de Jésus pour les chrétiens, l’« ère messianique » pour les Juifs et le « dernier jugement » pour les musulmans sont tous des « voyages dans l’espoir », informés par la révélation et renforcés par la réalisation mystique, « post-rationnelle », du « Soleil » divin tel qu’il se reflète au plus profond de la conscience de l’individu (88, 103). Burrell reconnaît cependant que le judaïsme fait très peu de références à l’au-delà et se concentre plutôt sur « l’héritage individuel enraciné dans la progéniture et les bonnes œuvres durables » (93). Il montre également une « similarité-dans-différence » ingénieuse entre l’islam et le christianisme en ce sens que l’islam perçoit la « parole de Dieu » comme « faite livre » (le Coran), tandis que le christianisme la perçoit comme « faite homme », c’est-à-dire le Christ. Il montre de manière éloquente comment une telle approche créative peut résoudre des différences apparemment inconciliables entre les deux traditions (112, 176).
Chapitre 6, « L’éschatologie réalisée : la foi comme mode de connaissance et de voyage », élargit davantage la manière dont chaque tradition dessine la forme de son objectif ultime au sein des moyens mêmes (« pèlerinages », spirituels et physiques) qu’elle propose pour y parvenir. Certains adeptes sont même capables d’échanger ces voies et de devenir des « traverseurs de frontières » (130). Burrell partage les histoires détaillées de ces « traverseurs ». Le principe de l’ahimsa (non-violence) de Gandhi, par exemple, bien qu’il soit hindou, a été profondément influencé par les idées de Tolstoï (134). Louis Massignon, islamologue français, est revenu au catholicisme après avoir été profondément transformé par son étude du soufisme (135). Le savant islamique Jawdat Said est particulièrement remarquable dans son interprétation du Coran comme un livre imposant une position de non-violence qui n’est pas différente de celle de Tolstoï et Gandhi (145-153).
Le chapitre 7, « Négocier respectueusement les questions névralgiques en suspens : contradictions et conversions », est unique en mettant l’accent sur les différences plutôt que sur les « grands schémas communs » ; néanmoins, il le fait de manière à procurer un surplus de clarté et à favoriser « la compréhension mutuelle » (166). Par exemple, l’accent mis par la tradition juive sur l’unicité divine telle qu’elle est formulée dans le shema («Ecoute, Israël, Dieu notre Dieu est Un»), a aidé les premiers chrétiens à articuler leur doctrine de manière à empêcher l’idolâtrie de Jésus en tant qu’ « être aux côtés de Dieu » (170, 186). Burrell considère que l’unanimité des musulmans quant au fait que le Coran est la « Parole de Dieu » infaillible (et même comme « Dieu enlivré ») est susceptible d’être mal interprétée par de nombreux juifs et chrétiens contemporains comme du « fondamentalisme » (171). De plus, les musulmans conçoivent Dieu comme parlant à travers le Coran lorsque quelqu’un le récite (172-3). Cependant, des analogies constructives peuvent être établies avec la manière dont les chrétiens croient que le Christ est « la Parole de Dieu » incarnée et reçoivent le « corps du Seigneur » lors de la communion, ou avec la notion de lectio divina (la lecture priante de la Bible) (173). Les théologiens musulmans, cependant, peuvent froncer les sourcils devant la certitude de Burrell qu’il n’y a aucune manière pour les musulmans de voir Muhammad comme un « médiateur » entre les musulmans et Dieu (174). En effet, le concept même de « messager » (rasul en arabe) présuppose la médiation : « Et Nous avons fait descendre vers toi le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été descendu » (Coran 16:44). Pour Burrell, les doctrines jouent plutôt un rôle grammatical que théorique dans nos vies : elles n’expliquent pas le réel, mais fournissent la manière dont la transformation personnelle permet une réponse à l’ultime (158). À son avis, ce sont la vie et les actes des figures notables de la foi qui nous permettent d’enraciner notre « cadre de référence » ou nos « points de repère » quant à ce qu’une doctrine systématique peut être lorsqu’elle est « incarnée » dans la vie réelle (158). Burrell affirme ensuite que « ni les adeptes ni les interlocuteurs ne sont en mesure d’évaluer la vérité d’une tradition révélée », et que, en ce qui concerne les revendications de foi, « le doute reste endémique » (181). L’affirmation de Burrell selon laquelle, pour favoriser la fécondité du dialogue, toutes les questions de vérité doivent d’une manière ou d’une autre être « mises entre parenthèses » (181), semble être tout à fait utilitariste – pourquoi quelqu’un resterait-il alors fidèle plutôt que douteux envers sa propre tradition à long terme, et comment un dialogue entre des traditions distinctes serait-il possible ?
Dans l’ensemble, le livre de Burrell est impressionnant par la gamme de questions philosophiques et théologiques complexes qu’il tente de couvrir, ainsi que par sa tentative globale d’engager de manière constructive des « similarités-dans-différences ». Chaque chapitre démontre la connaissance indéniablement profonde de Burrell de chaque tradition et fournit une multitude d’aperçus dialogiques pratiques. Cependant, le livre n’informe guère ses lecteurs d’une « théologie commune » qui pourrait potentiellement sous-tendre les trois traditions – quelque chose que le « ton » lonerganien autoproclamé du livre présupposerait qu’il fasse. Une tâche aussi énorme, cependant, ne peut que nécessiter un fondement méthodologique solide, et c’est précisément à ce stade que la « herméneutique créative » de Burrell soulève plus de questions que de réponses. Si les doctrines ne sont rien d’autre que les « distillations » des pratiques, qu’est-ce qui fonde les pratiques en premier lieu ? Pour éviter une régression ad infinitum, il doit s’agir de quelque chose d’autre qu’une autre pratique. La praxis est impensable sans des valeurs qui la propulsent, et Lonergan lui-même soulignerait que toutes les fondations doctrinales, tout en se basant sur la réponse à la question « Est-ce que quelque chose est précieux ? », ne peuvent qu’entretenir des relations polymorphes avec la réponse à la question de vérité antérieure : « Est-ce que quelque chose est vraiment ainsi ? » Burrell néglige toute systématique comme « prétentions » (5). On pourrait suggérer que le travail de Burrell, aussi perspicace soit-il, pourrait révéler un excédent encore plus grand de significations sous-jacentes aux trois traditions s’il mettait en œuvre une approche plus systématique.