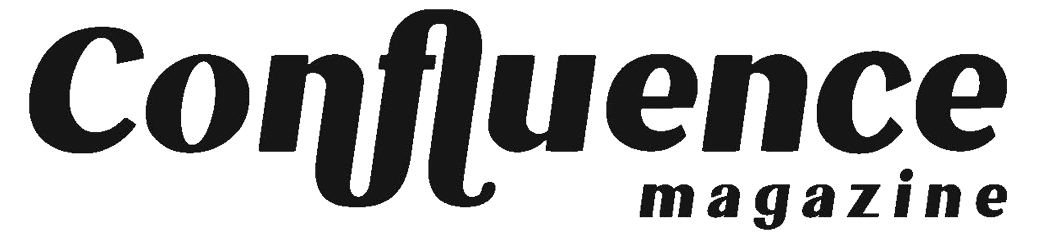Mathématiques
Hakan Oztunc
Même si l’impact des gains à la loterie sur le bien-être psychologique est influencé par divers facteurs, il est crucial de reconnaître que le bonheur est un concept complexe et multiforme.
Dans cet article
- La croyance selon laquelle la prospérité financière est automatiquement synonyme de bonheur suggère que la clé d’une vie facile réside dans un compte bancaire important ou dans un héritage. Bien que de nombreuses personnes aient envisagé cette idée à un moment donné de leur vie, l’argent peut-il acheter le bonheur ?
- La Tour de Hanoï a été reconnue comme un problème mathématique vers la fin du 19ème siècle et a depuis lors élargi les horizons des mathématiciens, offrant un aperçu de la formule du bonheur.
- Selon les prêtres Brahma, la fin du monde est attendue après environ six cents milliards de secondes, en supposant qu’une seconde soit passée sur chaque disque.
- Ce que veulent dire les brahmanes, c’est que le bonheur ne doit pas être retardé. Les conditions ne le lient pas. Ce n’est pas avec de l’argent. Le bonheur se trouve dans le moment présent, en travaillant pour une vie pleine de sens et en s’y engageant pleinement, ici et maintenant.
Tout au long de leur vie, les humains recherchent la formule insaisissable du bonheur. Le mythe du roi Midas illustre de manière poignante que le contrôle des circonstances extérieures ne mène pas nécessairement à une existence épanouie. Comme beaucoup d’individus, le roi Midas croyait qu’accumuler d’immenses richesses garantirait son bonheur. Ainsi, il a conclu un accord avec les « dieux », garantissant finalement la possibilité de transformer tout ce qu’il touchait en or. Cela semblait être une affaire extraordinaire qui garantirait son statut de personne la plus riche – et, par conséquent, la plus heureuse – du monde.
Cependant, le pauvre Midas découvrit bientôt la cruelle ironie de son souhait. Alors qu’il essayait de manger, la nourriture dans sa bouche se transformait en morceaux dorés non comestibles, et l’eau qu’il essayait de boire se solidifiait instantanément en or inextinguible. Piégé dans une prison dorée de sa propre fabrication, le roi Midas a connu sa disparition prématurée, entouré d’abondantes assiettes et coupes dorées. Cette histoire nous rappelle que la recherche de la richesse ne mène pas à elle seule au véritable bonheur ou à l’épanouissement.
Malheureusement, pour certaines personnes, la formule du bonheur semble d’une simplicité trompeuse : acquérir de la richesse. La croyance selon laquelle la prospérité financière est automatiquement synonyme de bonheur suggère que la clé d’une vie facile réside dans un compte bancaire important ou dans un héritage. Il est compréhensible que de telles pensées persistent, car de nombreuses personnes ont envisagé cette idée à un moment donné.
Dans une légende attribuée aux anciens prêtres Brahma, une promesse était faite d’accorder des disques d’or à une personne chanceuse, incitant les gens à visiter leurs temples et à en apprendre davantage sur leur religion. L’histoire raconte qu’à l’intérieur du temple de Brahma, il y avait 64 disques d’or disposés sur un pieu. À côté de ce pilier, deux postes supplémentaires étaient vides.
Les disques variaient en taille, le plus grand étant positionné en bas et chaque disque suivant diminuant en taille, culminant avec le plus petit en haut. Le plus petit disque pesait un kilogramme, tandis que le plus grand pesait 64 kilogrammes. Si l’on possédait non pas un ou deux, mais la totalité de ces disques d’or, la richesse cumulée serait stupéfiante : deux tonnes d’or. Imaginez la prospérité que l’on pourrait calculer à partir d’une telle collection, symbolisant une richesse et une abondance substantielles.
Une autre perspective pourrait comparer cela à gagner à la loterie. Les prêtres Brahma s’amusaient. Ils donnent au gagnant de ce jeu une chance de remporter ces disques d’or. Les règles du jeu étaient apparemment simples : déplacer les disques d’or du premier pôle au troisième, voire au deuxième pôle. Cependant, il y avait un piège : une minuscule stipulation d’une valeur potentielle de plusieurs milliards de dollars. Lors du transfert des disques du premier pôle au troisième, aucun disque plus grand ne pouvait reposer sur un plus petit. Les poteaux sont espacés de deux mètres. Au total, 2 080 kilogrammes de disques d’or attendaient d’être transférés du premier poteau vers les autres postes. Celui qui pourrait accomplir cette tâche sans violer la condition serait l’heureux possesseur de l’or. Cela pourrait ressembler à un conte sorti de la lampe d’Aladdin pour ceux qui ne connaissent pas les mathématiques qui se cachent derrière.
En réalité, les prêtres n’avaient pas l’intention de se séparer de l’or. La tâche à accomplir n’était pas simple : il faudrait des générations pour le terminer. Même si les descendants poursuivaient la mission, déplacer 64 disques d’or vers un autre pôle prendrait un temps inimaginable.
Ne vous trompez pas en supposant que ces disques peuvent être facilement transférés sur une courte distance. Le nombre minimum de coups à effectuer pour une carry légale n’est que de 15 pour trois disques et de 1023 pour dix disques. Pas de problème jusqu’à présent, mais cela ferait du coup 1 048 575 pour vingt disques. Pour 64 disques, le nombre monte en flèche jusqu’au chiffre stupéfiant de 18 446 744 073 709 551 615. Même selon l’estimation la plus optimiste d’une seconde par mouvement, le temps requis pour cette tâche est estimé à 600 milliards d’années. Pour mettre cela en perspective, l’univers entier a environ 13,7 milliards d’années, ce qui souligne l’ampleur stupéfiante du temps impliqué.
Ce que les prêtres pourraient sous-entendre, c’est l’étendue profonde de l’avidité humaine pour la richesse, un désir qui ne durera même pas un milliardième du temps nécessaire pour achever le remplacement des 64 disques. Alternativement, pourraient-ils suggérer que la vie est éphémère et ne devrait pas être préoccupée par des activités insignifiantes ? Ce n’est pas clair, c’est peut-être même un stratagème pour attirer les gens dans leurs temples. Cependant, un fait indéniable demeure : les applications mathématiques imprègnent divers aspects de la vie, et une connaissance des mathématiques s’avère essentielle.
Pensez-y : est-ce que quelqu’un ayant la capacité de jouer au jeu selon les règles et de calculer dès le départ qu’il est impossible de prendre tout l’or et de repartir visiterait un tel endroit ? Peut-être, poussé par la curiosité. Néanmoins, ce jeu, appelé la Tour de Hanoï, a été reconnu comme un problème mathématique vers la fin du XIXe siècle et a depuis lors élargi les horizons des mathématiciens, offrant un aperçu à la fois de l’or et de la formule du bonheur. Dans le problème de la Tour de Hanoï, le transfert de trois disques du premier bâton au troisième nécessite au moins sept mouvements. Le nombre de coups passe à 15 pour quatre disques et à 31 pour cinq disques, en suivant le modèle. Cela conduit à la formule du nombre minimum de transfert : 2n-1, où « n » est le nombre de disques. En appliquant cette formule aux 64 disques d’or mentionnés dans la légende, le nombre de coups est calculé comme étant de 264-1. Il est intéressant de noter que la même formule est utilisée pour déterminer le nombre de sous-ensembles pour les clusters au niveau collège-lycée, démontrant l’omniprésence et la polyvalence des principes mathématiques.
L’une des contributions les plus notables de ce problème a été son rôle dans la découverte du plus grand nombre premier connu jusqu’en 1951. À cette époque, le détenteur du record était le nombre 2127-1. Avant que les ordinateurs n’occupent une place centrale dans les efforts scientifiques, il était logique de relever ce défi manuellement, en déplaçant 127 disques pour calculer le nombre de mouvements nécessaires pour dévoiler le nombre premier connu le plus significatif ! Au-delà, une révélation surprenante lorsqu’on articule le mouvement de 5 disques : du plus petit disque au plus grand, cela devient une formulation intrigante, et une séquence apparaît.
Pour n=1, S1=1
Pour n=2, S2= 1, 2, 1
Pour n=3, S3=1, 2, 1, 3, 1, 2, 1
Pour n=4, S4= 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1
Pour n=5, S5=1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1
La séquence ici est remarquable. Le voyage vers le plus grand disque implique une progression incrémentielle de 1, 2 à 1, suivie d’un retour dans la même séquence, se terminant par une diminution d’un. Le premier mouvement est significatif dans la Tour de Hanoï. La structure algorithmique de la tour de Hanoï est utilisée comme matériel explicatif dans les cours de codage informatique. Le bon départ est le facteur le plus important pour terminer le jeu avec un minimum de mouvements. Cependant, la conclusion de la légende n’est pas particulièrement optimiste. Même si les 64 disques sont transférés avec succès, le résultat n’est pas joyeux, car le passage du temps annonce la fin du monde prochaine. Celui qui placera le dernier disque d’or sur le troisième pilier ne bénéficiera pas non plus de la richesse, car on pense que le chaos s’ensuivra. Selon les prêtres Brahma, la fin du monde est attendue après environ six cents milliards de secondes, en supposant qu’une seconde soit passée sur chaque disque. Ce que veulent dire les brahmanes, c’est que le bonheur ne doit pas être retardé. Les conditions ne le lient pas. Ce n’est pas avec de l’argent. Le bonheur se trouve dans le moment présent, en travaillant pour une vie pleine de sens et en s’y engageant pleinement, ici et maintenant. En outre, des études montrent que le bonheur est fonction de la réalité moins les attentes. Si certaines études montrent que le revenu est corrélé au bien-être et au bonheur, d’autres recherches, comme celle menée par le psychologue lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman, montrent qu’au-delà d’un certain seuil, compris entre 75 000 et 90 000 dollars par an, des ajustements peuvent être nécessaires pour tenir compte des variations de localisation ou d’autres facteurs [1].
En revanche, un revenu supplémentaire au-delà de ce seuil n’est pas corrélé à un bonheur ou à un bien-être accru. Le bien-être émotionnel semble culminer après la barre des 75 000 $. Dans une étude menée dans 164 pays, impliquant 1,7 million de participants, les individus ont été interrogés sur leur pouvoir d’achat, leur satisfaction dans la vie et leur bien-être général. Les résultats ont révélé que les personnes dont le revenu se situait entre 75 000 et 95 000 dollars déclaraient généralement les niveaux de bonheur les plus élevés.
Contrairement à la croyance populaire, ceux qui gagnent plus de 95 000 $ connaissent différents niveaux de bonheur. En explorant la relation mathématique entre richesse et bonheur, il semble présenter une structure exponentielle et parabolique. L’argent ne fait pas toujours le bonheur. Si nous visualisons un dessin courbe, avec l’argent sur l’axe X et le bonheur sur l’axe Y, et le graphique partant du point d’origine (0,0), nous observons une relation intéressante. Initialement, le graphique suggère une corrélation entre l’argent et le bonheur, faisant écho à la croyance commune selon laquelle sans argent, il n’y a pas de bonheur – une notion applicable dans de nombreux contextes mais qui n’est pas universellement vraie, comme dans le village de Piraha dans la jungle amazonienne.
Comme le montre le graphique, l’association entre l’argent et le bonheur n’est pas une ligne droite ; il suit un motif curviligne. Plus on a d’argent, plus le bonheur déclaré est élevé, mais cette augmentation n’est pas constante. Au lieu de cela, il culmine puis commence à décliner après un certain point. Les recherches ont identifié le sommet de cette courbe comme étant un revenu annuel de 95 000 $. Il convient de noter que le niveau de bonheur ne connaît qu’une amélioration marginale au-delà de 65 000 $ et qu’une fois le point maximum atteint, de nouvelles augmentations de revenu peuvent entraîner une diminution du bonheur.
Ce phénomène renforce l’idée qu’au-delà d’un certain seuil, l’argent supplémentaire ne contribue pas positivement au bonheur ; au lieu de cela, cela peut avoir l’effet inverse. Cela correspond au dicton : « Avez-vous de l’argent ? Alors vous avez un gros problème ! » car le graphique révèle un retour sur le bonheur décroissant après avoir atteint un niveau de revenu spécifique.
Cependant, une étude récente menée en 2021 auprès de plus d’un million de participants remet en question cette notion, indiquant qu’il n’y a peut-être pas de point d’inflexion définitif au-delà duquel une richesse accrue n’équivaut pas à un bonheur accru, du moins pas avant un salaire annuel de 500 000 dollars. Cette étude a utilisé une évaluation plus complète du bien-être, en se concentrant sur l’état émotionnel actuel des participants plutôt que de s’appuyer sur les souvenirs de leurs expériences passées au fil des semaines, des mois ou des années. Selon cette évaluation en temps réel, les personnes ayant des revenus significativement plus élevés ont déclaré éprouver des niveaux de bonheur élevés [2].
D’un autre côté, la situation géographique où résident même les gagnants de la loterie peut influencer considérablement les effets à long terme de leur nouvelle richesse sur le bien-être psychologique. Des facteurs tels que la culture locale, les réseaux de soutien social, l’accès aux ressources et aux services et les normes communautaires jouent tous un rôle dans la façon dont les individus perçoivent et vivent l’aubaine de la loterie. De plus, le coût de la vie, les opportunités économiques et les attentes en matière de mode de vie dans différents endroits contribuent à l’impact global des gains de loterie sur le bien-être psychologique au fil du temps.
Une étude suédoise notable se penche sur ce phénomène, examinant comment les gains à la loterie affectent la vie des individus. Étonnamment, même des années après avoir gagné, l’étude révèle que les gagnants à la loterie font systématiquement état d’une plus grande satisfaction dans la vie et d’un plus grand bien-être mental. Ils démontrent également une capacité accrue à surmonter des défis tels que le divorce, la maladie et la solitude par rapport aux personnes qui n’ont pas gagné à la loterie. La possession d’une somme d’argent substantielle a considérablement atténué les difficultés liées à ces événements de la vie des gagnants [3].
Même si l’impact des gains à la loterie sur le bien-être psychologique est influencé par divers facteurs, il est crucial de reconnaître que le bonheur est un concept complexe et multiforme. Au-delà des considérations financières, la satisfaction individuelle est façonnée par le contexte plus large de la vie et de l’environnement de chacun. L’étude suédoise sur les gagnants à la loterie en est une illustration convaincante. Malgré les effets positifs évidents sur la satisfaction de vivre et le bien-être mental des gagnants, cela souligne que le véritable bonheur ne se limite pas aux gains monétaires. La capacité de relever les défis de la vie, d’établir des liens significatifs et de s’épanouir dans ses activités personnelles font partie intégrante d’une vie heureuse. Par conséquent, même si la prospérité financière peut certainement atténuer certaines difficultés, la compréhension plus large du bonheur s’étend au-delà des limites de la richesse.
En résumé, les résultats de ces études montrent que le bonheur n’est pas nécessairement lié à la richesse matérielle et matérialiste. Au contraire, les moyens financiers dont on dispose peuvent produire différents niveaux de satisfaction. Il est intéressant de noter que les résultats révèlent également que les individus appartenant aux groupes à faible revenu ont tendance à exceller dans la découverte de moyens de donner un sens à la vie, de trouver la joie et de cultiver le bonheur, même dans les contraintes de leurs conditions limitées. Cela suggère que la recherche et l’atteinte du bonheur sont complexes et peuvent être obtenues par diverses voies, transcendant la simple accumulation de richesses.
Références
- High income improves evaluation of life but not emotional well-being, Daniel Kahneman and Angus Deaton, September 7, 2010,107 (38) 16489-16493, https://doi.org/10.1073/pnas.1011492107
- “Experienced well-being rises with income, even above $75,000 per year.” Matthew A. Killingsworth, PNAS, January 18, 2021, 118 (4) e2016976118 https://doi.org/10.1073/pnas.2016976118
- “Long-Run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-Being,” Erik Lindqvist, Robert Östling, David Cesarini,The Review of Economic Studies, Volume 87, Issue 6, November 2020, Pages 2703–2726, https://doi.org/10.1093/restud/rdaa006