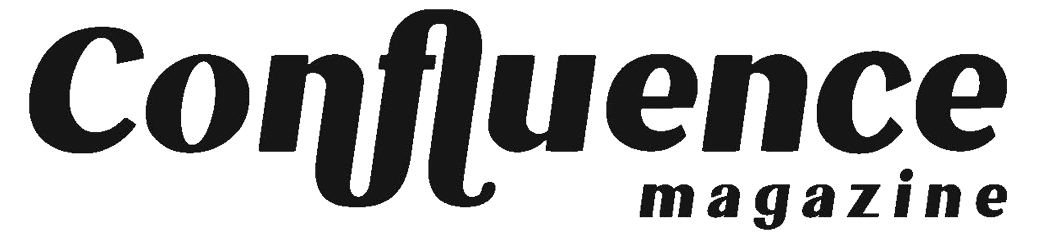Dans cet article
- Les outils d’intelligence artificielle (IA), notamment les agents basés sur des modèles de langage à grande échelle (MLL) comme ChatGPT et LLaMA, s’intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne grâce à leur remarquable aisance à générer du texte.
- Les climatologues révèlent que des millions d’enfants d’aujourd’hui seront exposés à des phénomènes climatiques extrêmes tout au long de leur vie si les politiques climatiques mondiales actuelles restent inchangées.
Ce que les troubles du langage révèlent sur les chatsbots

Watanabe et al. Comparaison du modèle de langage à grande échelle avec l’aphasie. Advanced Science, mai 2025.
Les outils d’intelligence artificielle (IA), en particulier les agents basés sur le modèle de langage à grande échelle (LMM – angl. Large Language Model) comme ChatGPT et LLaMA, s’intègrent de plus en plus dans la vie quotidienne grâce à leur remarquable fluidité dans la génération de texte. Cependant, ces systèmes produisent souvent des informations fiables, mais erronées, qui peuvent induire en erreur les utilisateurs peu familiarisés avec le sujet. Dans une étude récente, des chercheurs ont montré que ce comportement est étonnamment similaire à un trouble du langage humain appelé aphasie de Wernicke.
Dans cette condition, les individus parlent couramment, mais produisent souvent des déclarations confuses ou dénuées de sens. L’équipe de recherche a exploré cette similitude à l’aide d’une méthode appelée analyse du paysage énergétique, initialement développée en physique puis adaptée aux neurosciences. Cette méthode visualise le comportement des états cérébraux ou des schémas de signaux internes dans les systèmes d’IA. Ils ont comparé l’activité cérébrale de personnes atteintes de divers types d’aphasie aux schémas de signaux internes des LLM. L’étude a révélé des similitudes surprenantes, notamment dans le traitement de l’information et la circulation des signaux au sein des systèmes. Dans les deux cas – aphasie humaine et modèles d’IA – les schémas de signaux peuvent devenir chaotiques ou trop rigides, entrainant des résultats incohérents. Cette découverte offre des avancées potentielles dans deux domaines. Pour les neurosciences, elle pourrait fournir de nouveaux outils de diagnostic pour identifier et surveiller l’aphasie en se basant sur l’activité cérébrale plutôt que sur les seuls symptômes de la parole. Pour le développement de l’IA, la compréhension de ces schémas internes pourrait aider les ingénieurs à concevoir des systèmes gérant les connaissances avec plus de souplesse et de précision. Si les chercheurs mettent en garde contre une surinterprétation des résultats – soulignant que l’IA ne provoque pas de lésions cérébrales –, ils suggèrent que ces similitudes internes pourraient guider la création d’une IA plus fiable et plus intelligente à l’avenir. À terme, cette approche interdisciplinaire pourrait améliorer les diagnostics médicaux et la fiabilité des outils d’IA.
Des milliards d’enfants pourraient être confrontés à des extrêmes climatiques sans précédent

Grant et al. Émergence mondiale d’une exposition sans précédent tout au long de la vie aux extrêmes climatiques. Nature, mai 2025.
Les climatologues révèlent que des millions d’enfants d’aujourd’hui seront exposés à des évènements climatiques extrêmes tout au long de leur vie si les politiques climatiques mondiales actuelles restent inchangées. Dans un scénario de fortes émissions entrainant une hausse de 3,5 °C des températures mondiales d’ici 2100, 92 % des enfants nés en 2020, soit environ 111 millions, devraient subir des vagues de chaleur record au cours de leur vie. En revanche, limiter le réchauffement climatique à l’objectif de 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris pourrait protéger 49 millions de ces enfants d’une telle exposition. En incluant tous les enfants âgés de 5 à 18 ans aujourd’hui, 1,5 milliard seraient concernés dans le scénario de 3,5 °C. Cependant, si le réchauffement est limité à 1,5 °C, 654 millions d’entre eux pourraient être épargnés par ces impacts extrêmes. L’étude montre que les enfants, en particulier ceux des régions tropicales et des pays à faible revenu, seront confrontés à des risques climatiques bien plus importants que toutes les générations précédentes. Ceux des communautés les plus vulnérables sur le plan socio-économique sont susceptibles d’en subir les conséquences les plus graves.
Les chercheurs ont utilisé des données démographiques et des modèles climatiques pour évaluer l’exposition générationnelle à six types de phénomènes climatiques extrêmes : vagues de chaleur, sècheresses, mauvaises récoltes, incendies de forêt, cyclones tropicaux et crues fluviales. Leurs conclusions révèlent une importante injustice intergénérationnelle. Par exemple, avec un réchauffement climatique de 1,5 °C, 52 % des enfants nés en 2020 seraient encore exposés à des vagues de chaleur sans précédent, contre seulement 16 % de ceux nés en 1960. Cela souligne l’urgence d’une action climatique mondiale. Alors que le réchauffement climatique est actuellement en passe de dépasser 2,7 °C, l’étude exhorte les dirigeants mondiaux à s’engager à des réductions d’émissions plus ambitieuses. Le message est clair : une action climatique urgente et équitable est essentielle pour préserver l’avenir de la jeunesse d’aujourd’hui.