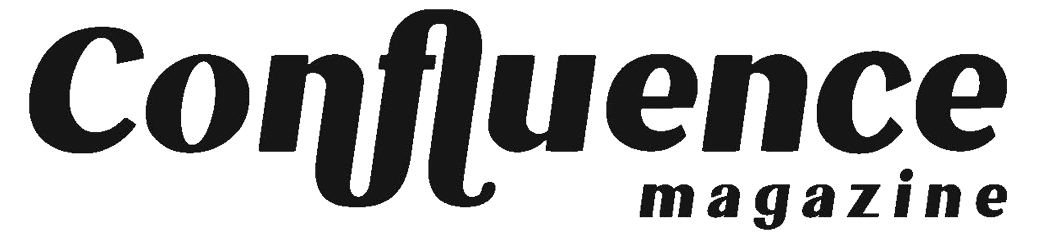John N. Dorner
Le dialogue consiste à exprimer authentiquement qui je suis, qui nous sommes. Il s’agit de s’écouter et d’apprendre les uns des autres dans un esprit d’amour, de respect et de dialogue. Cette mission nous aide à parvenir à la paix et à l’harmonie les uns avec les autres en découvrant et en respectant non seulement nos différences, mais aussi les points communs que nous partageons. Le point commun consiste à apprendre à se connaître et à prendre soin les uns des autres. De nos jours, il s’agit aussi beaucoup de notre protection et de notre souci de l’environnement. Nous devons vivre de manière à ce que toute vie soit chérie, protégée et améliorée.
La foi verte signifie prendre soin de la création de Dieu du point de vue de la foi. Ma foi est chrétienne – la foi de mes parents et de mes ancêtres au sein de la tradition catholique romaine. Depuis la petite enfance jusqu’à aujourd’hui, mes expériences de vie m’ont amené à exprimer ma foi – ma croyance en un Dieu Créateur aimant – par des paroles et des actions qui démontrent l’amour de Dieu et du prochain et le respect de toute la création.
Nous faisons tous partie d’une seule famille humaine. Nous sommes tous frères et sœurs sur cette planète. Dans ma tradition, nous sommes tous considérés comme des enfants de Dieu. Ce qui m’inquiète, c’est que la maison que nous partageons, la planète Terre, est dans un état périlleux et que nous sommes confrontés à une crise urgente. Il est difficile d’y faire face et d’en parler. Faire face à la vérité peut être difficile et nous disposons tous de mécanismes d’adaptation pour gérer les informations difficiles. Qui veut entendre de mauvaises nouvelles ? Qui a envie de parler de mauvaises nouvelles ? Par exemple, qui aime entendre que l’Académie nationale des sciences des États-Unis rapporte qu’environ 97 à 98 pour cent des plus éminents experts en science du climat pensent que les humains sont à l’origine du réchauffement climatique ; qu’une crise climatique est en train de se dérouler, comme en témoignent les événements météorologiques extrêmes, le recul des glaciers et l’élévation rapide du niveau de la mer ; que des millions de personnes sont aujourd’hui confrontées à la famine en raison de la désertification de leurs terres, un fait attribué à l’érosion des sols et au changement climatique ; qu’environ la moitié des forêts tropicales et tempérées de la planète ont déjà été détruites et que la perte des forêts se poursuit à un rythme inquiétant ; que selon le Conseil mondial de l’eau, plus de 1,1 milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable et 3,4 millions de personnes meurent chaque année de maladies évitables liées à l’eau ; que les récifs coralliens disparaissent et que nous sommes confrontés à une perte massive de biodiversité.
Vous vous dites peut-être que je sais qu’il y a des problèmes et que je n’ai pas besoin d’en entendre parler sans cesse. C’est un défi pour moi et peut-être pour vous aussi. Devons-nous éviter les faits ? Sommes-nous engagés dans le déni ? Ou devons-nous faire face aux faits et agir conformément à nos enseignements de foi, ouvrant ainsi la porte à l’espoir pour l’avenir ? En travaillant ensemble, nous exploitons le réservoir de nos forces et nous apportons de l’espoir à notre monde. C’est pourquoi je souhaite que nous tous, quelles que soient notre foi et nos origines culturelles, quelles que soient nos responsabilités dans la vie quotidienne, travaillions ensemble et nous entraidions pour faire une différence dans notre monde en prenant soin de notre maison – la planète Terre.
Chacun de nous a une histoire qui nous amène à notre propre « foi verte » – la source ultime de sens partagé au sein de notre communauté religieuse qui fournit le cadre moral et éthique de la façon dont nous vivons sur cette terre. Laissez-moi partager avec vous une de mes histoires.
Lorsque j’ai commencé comme directeur de l’école St. Anthony, j’ai demandé aux enseignants quelle était leur priorité pour les cinq prochaines années. L’école comptait une population très diversifiée, avec de nombreux enfants issus de familles immigrées, y compris des réfugiés. Une enquête a révélé que 42 langues étaient parlées dans les foyers de nos enfants. Les enseignants m’ont informé que l’école avait un projet basé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des enfants, qui comprend une déclaration selon laquelle les enfants ont le droit d’être entendus sur les questions qui les concernent. Après avoir écouté leurs élèves, ils m’ont informé que l’une des principales priorités des enfants était de pouvoir s’asseoir à l’ombre d’un arbre dans leur cour d’école. La cour d’école était un terrain vague, 100 % asphalté. Nous avons participé au concours de la cour d’école la plus laide parrainé par le Jour de la Terre Ottawa et l’Institut canadien de la biodiversité. Nous avons gagné ! Cela nous a donné du financement. Nous avons planté de nombreux arbres et il y a maintenant une petite forêt dans la cour de l’école. Les enfants étaient ravis.
Si nous regardons la création de Dieu à travers les yeux d’un enfant, nous ne sommes pas embrouillés par le discours politique. Au contraire, nous sommes humbles et impressionnés. Comme indiqué dans les Écritures, Marc 18 : « À cette époque-là, les disciples vinrent vers Jésus et dirent : « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et lui appelant un enfant, il le plaça au milieu d’eux et dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des enfants, vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux. Celui qui s’humilie comme cet enfant., il est le plus grand du royaume des cieux.' »
Dans notre humilité, nous sentons notre responsabilité envers la création, envers les pauvres, envers nos enfants et envers les générations futures. Si nous attendons la résolution de toutes les incertitudes scientifiques, nous risquons de nuire aux pauvres, à nos enfants et aux générations futures. N’est-ce pas la manière de nos religions d’être ouvertes à des modes de vie qui sont cohérents avec nos enseignements religieux ? Il ne s’agit pas tant de ce que j’ai, mais de qui je suis. Il s’agit de ma relation avec Dieu et le prochain. Nous agissons maintenant ensemble pour le bien commun. Ce faisant, nous partageons l’espoir pour l’avenir.
Au cours des six dernières années, j’ai servi et je continue de servir comme agent de liaison pour la gestion de l’environnement au sein de l’archidiocèse catholique romain d’Ottawa. J’ai été le représentant à Ottawa du réseau interconfessionnel Faith and the Common Good, et je continue de travailler avec cette organisation à titre de liaison, en soutenant les efforts de gestion de l’environnement parmi une variété de traditions religieuses. On me rappelle constamment que nos traditions partagent des principes moraux et éthiques communs en ce qui concerne le soin de la Terre. Ces valeurs sont exprimées explicitement par des mots dans les Écritures, dans le Coran et dans les textes sacrés de toutes les confessions et dans leurs enseignements. Nous partageons un terrain d’entente.
Je vais prendre un moment pour me concentrer sur la Création. Par exemple, le Livre de la Genèse dans l’Ancien Testament et le Coran identifient clairement Dieu comme Créateur. La façon dont ces lectures sont interprétées a un impact sur notre façon de vivre. Par exemple, dans Genèse 1, il est écrit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance… Et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant. qui bouge sur la terre. »
En tant que personnes créées à l’image de Dieu, comment interprétons-nous l’exercice de la « domination » dans le monde actuel marqué par le changement climatique, l’extinction des espèces et la perte de la biodiversité ? Dans Genèse 2, il est écrit : « Le Seigneur Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder. » En hébreu, le mot utilisé dans cette citation est « shomrah », qui signifie protéger et sauvegarder. Dans le Coran, il est également écrit que Dieu a bien fait tout ce qu’il a créé et nous a ordonné de le conserver ainsi. Une traduction anglaise du Coran déclare : « (Dieu) a fait du bien tout ce qu’Il a créé » (32 :7) et « Ne faites pas de mal sur la terre, une fois qu’elle a été mise en ordre » (7 :56). En effet, nous avons la responsabilité de prendre soin de la terre.
Où allons-nous à partir d’ici ? Je dirais que nous devons tous agir sur la base de nos traditions religieuses et nous engager dans des actions qui soutiennent la protection de l’ensemble de la création. Je suis touché par les Écritures, notamment par une citation de Jacques (2 : 18) : « Mais quelqu’un dira : ‘Vous avez la foi et j’ai les œuvres.’ Montre-moi ta foi en dehors de tes œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. »
Quels types d’actions reflètent les principes moraux de la foi ? De plus en plus, nous constatons la publication d’idées dans des ressources fournies par nos traditions religieuses respectives, y compris des ressources en ligne. J’ai trouvé très utile d’accéder aux ressources de Faith and the Common Good. Par exemple, Foi et Bien Commun a développé une affiche intitulée « La Règle verte » avec des paroles d’un certain nombre de grandes traditions religieuses et spirituelles du monde, démontrant qu’à la base, toutes ont une conscience du caractère sacré de la création. Cette organisation propose un programme pratique appelé Greening Sacred Spaces, conçu pour aider les communautés religieuses à prendre des mesures pour créer un lieu de culte plus durable et économe en énergie, et pour éduquer les membres de la communauté sur les questions écologiques (les ressources sont disponibles par voie électronique et sans frais à greeningsacredspaces.net). Des ateliers sont également proposés. Par exemple, le programme Greening Sacred Spaces a récemment reçu une subvention du Fonds de développement durable d’Ottawa pour réaliser des audits écologiques et organiser des ateliers qui soutiennent la gestion de l’environnement. L’un des événements organisés était une visite en éco-bus qui a amené les participants à voir le bon travail effectué dans une mosquée, dans des églises et au Tucker House Renewal Centre. D’autres ateliers sont à venir. Cela renforce l’engagement interconfessionnel. Cela donne de l’espoir pour l’avenir alors que de plus en plus de communautés religieuses font la différence.
Continuons à soutenir nos dialogues interculturels et interreligieux. Nous devons répondre à la crise environnementale qui se développe avec un espoir fondé sur l’expression de la foi dans l’action. Il faut écouter les enfants. Nous devons écouter le cri des pauvres. Nous devons prendre au sérieux l’appel à nous convertir à des modes de vie qui soutiennent la justice écologique. C’est notre responsabilité, quel que soit notre rôle dans la société. Continuons à nous écouter les uns les autres pour mieux nous connaître. Œuvrons pour un monde de paix où « la richesse de la diversité humaine et religieuse est tissée dans le tissu de la vie communautaire, civile et sociétale ».
Avec la foi en l’action vient l’espoir pour l’avenir de notre planète. C’est la Foi Verte.