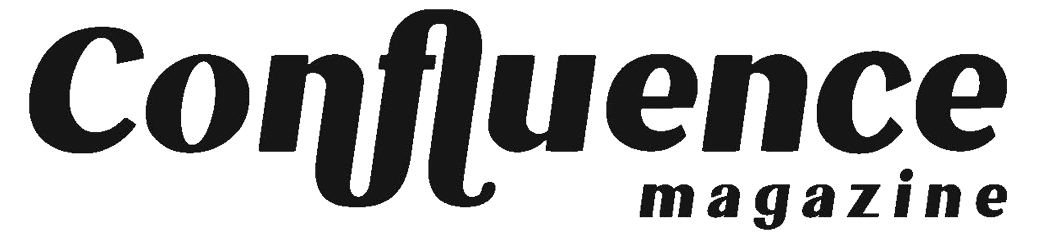Sumeyra Tosun
La présence du langage est une caractéristique humaine déterminante, nous distinguant des autres espèces.
Dans cet article
- Le langage façonne considérablement la pensée en facilitant le transfert d’idées entre les esprits. Chaque langue influence fortement les cadres conceptuels dont disposent ses locuteurs, limitant ou guidant des activités mentales comme la catégorisation, la mémoire, le raisonnement et la prise de décision.
- Les locuteurs de langues basées sur des directions absolues excellent en orientation spatiale, même dans des environnements inconnus. Leurs langues cultivent et renforcent cette compétence cognitive. Les différences de perception spatiale peuvent également s’étendre à la pensée temporelle.
- Les représentations du temps sont diversifiées à l’échelle mondiale. Les anglophones voient le futur comme « devant » et le passé comme « derrière ». Inconsciemment, les anglophones ont tendance à se pencher en avant lorsqu’ils envisagent le futur et en arrière lorsqu’ils envisagent le passé. À l’inverse, en aymara, une langue parlée dans les Andes, le passé est appelé « devant » et le futur comme « derrière ». Il est intéressant de noter que les locuteurs aymaras font des gestes devant eux lorsqu’ils parlent du passé et derrière eux lorsqu’ils évoquent le futur.
- Des recherches démontrent que la modification du langage a un impact sur les processus cognitifs. L’introduction de nouveaux termes de couleur ou la modification des expressions temporelles peuvent modifier la capacité des individus à percevoir les couleurs ou à conceptualiser le temps.
La présence du langage est une caractéristique humaine déterminante, nous distinguant des autres espèces. Dès la petite enfance, les nourrissons réagissent positivement aux mélodies de leur langue d’exposition et ont tendance à s’éloigner de ceux qui parlent un autre dialecte ou une autre langue (Kinzler, Shutts, DeJesus et Spelke, 2009). Partout dans le monde, les individus communiquent à travers un ensemble diversifié d’environ 7 000 langues, chacune imposant des exigences spécifiques à ses locuteurs (Boroditsky, 2011).
Considérez ceci : exprimer que ma tante a donné cinq gants bleus à son amie varie considérablement d’une langue à l’autre. En picard, le choix du verbe indique si l’événement s’est produit récemment, hier ou dans un passé lointain. Les verbes indonésiens ne précisent pas si l’événement a eu lieu ou est à venir. Les verbes turcs indiquent si j’étais présent ou si je l’ai entendu de quelqu’un d’autre. Le russe exige des précisions sur la nuance de bleu. Le mandarin exige de préciser le lien de parenté de la tante, par le sang ou par alliance, ainsi que son origine maternelle ou paternelle. En arabe, je dois indiquer le sexe de son amie. En pirahã, exprimer « cinq » est impossible ; on utilise des mots pour « peu » ou « beaucoup » au lieu de chiffres exacts. Malgré ces différences linguistiques, les variations de langage ne sont pas nécessairement synonymes de modes de pensée différents. Comment savoir si les locuteurs de picard, de turc, de russe, d’indonésien, de mandarin, d’arabe ou de pirahã perçoivent, se souviennent et raisonnent réellement différemment du monde en raison de leurs langues parlées ?
D’un point de vue pratique, le langage façonne considérablement la pensée en facilitant le transfert d’idées entre les esprits. Selon l’hypothèse de Whorf-Sapir, chaque langue influence fortement les cadres conceptuels accessibles à ses locuteurs, limitant ou guidant des activités mentales telles que la catégorisation, la mémoire, le raisonnement et la prise de décision. Ce point de vue suggère que les structures linguistiques agissent comme un modèle pour les processus mentaux d’un individu. L’exploration de divers systèmes linguistiques pourrait éclairer les différents modes de pensée cultivés ou influencés par ces langues. Le cadre de réflexion pour la parole de Slobin (1996, 2003) suggère que les locuteurs ont tendance à conceptualiser les événements d’une manière qui s’aligne sur la structure de leur langue, adoptant finalement des schémas de pensée similaires à leurs habitudes de parole ou d’écriture au fil du temps.
Nous commençons par un exemple marquant de la façon dont le langage façonne les catégories perceptives : le phénomène de perception catégorielle des phonèmes. Initialement, les enfants peuvent discerner toutes les propriétés acoustiques et phonétiques utilisées par les langues pour transmettre du sens (Eimas, Siqueland, Jusczyk et Vigorito, 1971). Cependant, à l’époque où l’acquisition du langage commence, les nourrissons, âgés d’environ un an, commencent à perdre leur sensibilité aux différences phonétiques qui ne sont pas phonémiques (c’est-à-dire qui n’influencent pas les niveaux supérieurs de la structure linguistique) dans la langue à laquelle ils sont exposés (Werker et Tees, 1984).
Explorons le Pormpuraaw, où la langue Kuuk Thaayorre adopte une approche unique des directions spatiales. Contrairement à l’anglais, qui utilise des termes comme « gauche » et « droite », le Kuuk Thaayorre s’appuie sur des points cardinaux absolus (nord, sud, est, ouest, etc.). Alors que l’anglais utilise les points cardinaux principalement à grande échelle, le Kuuk Thaayorre les intègre à tous les niveaux. Ainsi, des expressions comme « la tasse est au sud-est de l’assiette » ou « le garçon au sud de Marie est mon frère » sont courantes. En Pormpuraaw, une orientation constante est nécessaire pour une bonne communication.
Les recherches révolutionnaires menées par Stephen C. Levinson au cours des deux dernières décennies ont révélé que les locuteurs de langues dépendant de directions absolues excellent en orientation spatiale, même dans des environnements inconnus. Ils surpassent les individus vivant dans des contextes similaires et ne parlant pas ces langues, dépassant ainsi ce que les scientifiques pensaient être humain. Leurs langues cultivent et améliorent cette compétence cognitive. Les différences de perception spatiale peuvent également s’étendre à la pensée temporelle. Par exemple, Alice Gaby et ses collègues ont testé la capacité des locuteurs du kuuk thaayorre à séquencer des photographies mélangées illustrant la progression de l’âge, la croissance ou la consommation, en observant des approches uniques pour organiser ces images afin de refléter le bon ordre temporel. Ils ont réalisé deux tests, chaque personne étant positionnée dans une direction cardinale différente. Dans cette tâche, les anglophones disposent généralement les cartes de gauche à droite, reflétant la progression du temps. Les locuteurs hébreux, quant à eux, ont tendance à organiser les cartes de droite à gauche, en s’alignant sur leur sens d’écriture. Cependant, les kuuk thaayorre appréhendent le temps différemment. Ils ont disposé les cartes d’est en ouest, en ajustant leur disposition selon leur orientation : face au sud, les cartes progressaient de gauche à droite ; face au nord, de droite à gauche ; face à l’est, elles se déplaçaient vers le corps, et ainsi de suite. Cette orientation spatiale unique était utilisée spontanément, sans aucun indice extérieur quant à leur orientation.
Les représentations du temps sont diversifiées à travers le monde. Par exemple, les anglophones voient le futur comme « devant » et le passé comme « derrière ». En 2010, Lynden Miles et ses collègues ont observé que les anglophones ont tendance à se pencher inconsciemment en avant lorsqu’ils envisagent le futur et en arrière lorsqu’ils envisagent le passé. À l’inverse, en aymara, une langue parlée dans les Andes, le passé est considéré comme « devant » et le futur comme « derrière ». Il est intéressant de noter que la gestuelle des locuteurs aymaras est en phase avec leur langue ; des recherches menées par Raphael Núñez et Eve Sweetser en 2006 ont montré que les locuteurs aymaras gesticulent devant eux lorsqu’ils évoquent le passé et derrière eux lorsqu’ils évoquent le futur.
Dans certaines langues, l’organisation des catégories et des termes de couleur diffère sensiblement de l’anglais. Par exemple, en berinmo (parlé en Papouasie-Nouvelle-Guinée) et en himba (parlé en Namibie), il n’existe pas de termes distincts pour le vert et le bleu ; un seul mot désigne les deux couleurs. Une étude de Roberson et al. (2000, 2005) a exploré le phénomène de perception catégorielle (PC) de la couleur chez les locuteurs anglais, berinmo et himba. La PC désigne la discriminabilité accrue des couleurs qui franchissent une limite de catégorie par rapport à celles d’une même catégorie. Au cours de l’étude, les participants ont vu une cible colorée et devaient identifier lequel des deux stimuli présentés cinq secondes plus tard correspondait à la cible. Dans chaque groupe linguistique, les performances étaient meilleures lorsque la cible et le stimuli distracteur portaient des noms de couleur différents (par exemple, en anglais, une cible bleue avec un distracteur violet) que lorsqu’ils partageaient le même nom (par exemple, deux nuances de bleu différentes en anglais). Les résultats ont montré une CP chez les trois groupes de participants, mais plus particulièrement aux limites de couleur explicitement indiquées dans leurs langues respectives. Il est important de noter qu’aucun effet CP n’a été observé à la limite universelle proposée entre le vert et le bleu pour les locuteurs himba et berinmo, dont les langues ne font pas de distinction entre ces couleurs.
Les langues diffèrent dans leur façon de catégoriser les substances, notamment en distinguant les noms de masse des noms dénombrables. Dans de nombreuses langues, dont l’anglais, les noms dénombrables sont couramment utilisés pour les éléments dénombrables et apparaissent au singulier et au pluriel, permettant ainsi l’énumération. En revanche, les noms de masse (par exemple, sable et terre) ne peuvent pas être comptés de la même manière et n’ont pas de contexte singulier ou pluriel (*quelques sables et *deux terre). Cependant, dans des langues comme le maya yucatèque, les noms manquent de spécification pour l’individuation. Au lieu d’indiquer une unité, ils désignent simplement la substance ou le matériau d’un objet. Par exemple, au lieu de dire deux bougies, ils pourraient exprimer « deux unités de cire longue et fine ». Lucy (1993) a mené une étude auprès de participants mayas yucatèques et anglophones. On leur a montré un objet et on leur a demandé de déterminer laquelle des deux options était la plus similaire, l’une ressemblant à l’original par la forme et l’autre par la substance. L’étude a révélé que tandis que les anglophones privilégiaient le choix correspondant à la forme, les Mayas du Yucatèque partageaient leurs préférences entre les deux alternatives.
Dans une étude de Boroditsky et ses collègues (2003), des germanophones et des hispanophones ont été invités à décrire des objets assignés à un genre dans leurs langues respectives. Les descriptions données correspondaient au genre grammatical prédit. Par exemple, lorsqu’on leur demandait de décrire une « clé » – un mot masculin en allemand et féminin en espagnol –, les germanophones avaient tendance à utiliser des mots comme « dur », « lourd », « dentelé », « métallique », « dentelé » et « utile », tandis que les hispanophones préféraient « doré », « complexe », « petit », « joli », « brillant » et « minuscule ». À l’inverse, pour un « pont », féminin en allemand et masculin en espagnol, les germanophones utilisaient des descripteurs comme « beau », « élégant », « fragile », « paisible », « joli » et « minuscule », tandis que les hispanophones utilisaient « grand », « dangereux », « long », « fort », « robuste » et « imposant ». Il est remarquable de constater que ces différences ont persisté malgré le fait que tous les tests aient été effectués en anglais, une langue sans genre grammatical.
L’évidentialité, une caractéristique linguistique, révèle la source d’informations relatives à des événements passés, qu’elle provienne d’une expérience sensorielle directe, d’ouï-dire ou d’inférence. Dans des langues comme le turc, l’évidentialité est grammaticalement ancrée, obligeant les locuteurs à préciser leur source d’information. En revanche, dans des langues comme l’anglais, cette caractéristique est plus souple et facultative, s’exprimant par le vocabulaire plutôt que par la grammaire. Dans une étude de Tosun, Vaid et Geraci (2013), les locuteurs turcs étaient capables de reconnaître des informations de première main, tout comme les anglophones. En revanche, pour les informations de seconde main, les locuteurs turcs étaient moins performants que les anglophones. Les personnes bilingues turc-anglais obtenaient des résultats comparables aux monolingues turcs aux tests de turc et comparables aux monolingues anglais aux tests d’anglais. Cependant, les bilingues turc-anglais tardifs continuaient de ressembler aux monolingues turcs, même aux tests d’anglais, affichant une précision moindre dans la reconnaissance des informations de seconde main que des détails de première main.
Des recherches démontrent que la modification du langage influence les processus cognitifs. L’introduction de nouveaux termes de couleur ou la modification des expressions temporelles peuvent modifier la capacité des individus à percevoir les couleurs ou à conceptualiser le temps. Cela rejoint le dicton turc « une langue, une personne », suggérant que chaque langue apprise façonne une perspective cognitive distincte. C’est pourquoi, lorsque je lis les versets suivants du Coran, j’interprète la création de la diversité par Dieu comme un moyen de mieux nous comprendre, de développer nos potentialités et de nous améliorer en tant qu’individus.
Parmi Ses signes, il y a la création des cieux et de la terre, ainsi que la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il y a là, certes, des signes pour des gens savants. (30 :22)
Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un seul mâle et d’une seule femelle, et Nous vous avons répartis en tribus et en familles afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est certainement celui qui est le plus pieux, le plus juste et le plus respectueux de Dieu. Dieu est Omniscient et Parfaitement Connaisseur. (49 :13)
References
- Boroditsky, L., Schmidt, L. A., & Phillips, W. (2003). Sex, syntax, and semantics. Language in Mind: Advances in the Study of Language and Thought, 22, 61-79.
- Boroditsky, L. (2011). How language shapes thought. Scientific American, 304(2), 62-65.
- Boroditsky, L., & Gaby, A. (2010). Remembrances of times East: absolute spatial representations of time in an Australian aboriginal community. Psychological science, 21(11), 1635-1639.
- Eimas, P., Siqueland, E., Jusczyk, P., & Vigorito, J. (1971). Speech perception in infants. Science, 171, 303-306.
- Keller, H. (1955). Teacher: Anne Sullivan Macy. Westport, Conn.: Greenwood Press.
- Kinzler, K. D., Shutts, K., DeJesus, J., & Spelke, E.S. (2009). Accent trumps race in guiding children’s social preferences. Social Cognition 27:4, 623-634.
- Levinson, S. C. (2003) Space in language and cognition: Explorations in linguistic diversity. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lucy, J. A. (1993). Metapragmatic presentationals: reporting speech with quotatives in Yucatec Maya. Reflexive Language: Reported Speech and Metapragmatics, 91-125.
- Miles, L., Nind, L., & Macrae, C. (2010). Moving through time. Psychological Science, 21(2), 222.
- Núñez, R. E., & Sweetser, E. (2006). With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time. Cognitive Science, 30(3), 401-450.
- Roberson, D., Davidoff, J., Davies, I. R., & Shapiro, L. R. (2005). Color categories: Evidence for the cultural relativity hypothesis. Cognitive Psychology, 50(4), 378-411.
- Roberson, D., Davies, I., & Davidoff, J. (2000). Color categories are not universal: replications and new evidence from a stone-age culture. Journal of Experimental Psychology: General, 129(3), 369.
- Sapir, E. (1941). In L. Spier, Language, culture and personality: essays in memory of Edward Sapir. Menasha, WI: Memorial Publication Fund. Cited in Whorf (1956, p. 134).
- Slobin, D. (1996). From ‘thought and language’ to ‘thinking for speaking’. In J. Gumperz & S. C. Levinson (eds.), Rethinking linguistic relativity, 70-96. Cambridge: Cambridge University Press.
- Slobin, D. (2003). Language and thought online: Cognitive consequences of linguistic relativity. In D. Gentner & S. Goldin-Meadow (eds.), Language in mind: Advances in the investigation of language and thought, 157-191. Cambridge, MA: MIT Press.
- Tosun, S., Vaid, J., & Geraci, L. (2013). Does obligatory linguistic marking of source of evidence affect source memory? A Turkish/English investigation. Journal of Memory and Language, 69(2), 121-134.
- Werker, J., & Tees, R. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. Infant Behavior and Development, 7, 49-63.
- Whorf, B.L. (1956). Language, Thought and Reality. Ed. by J. Carroll. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wittgenstein, L. (1922). Tractatus Logico-Philosophicus. Ed. by D.F. Pears.