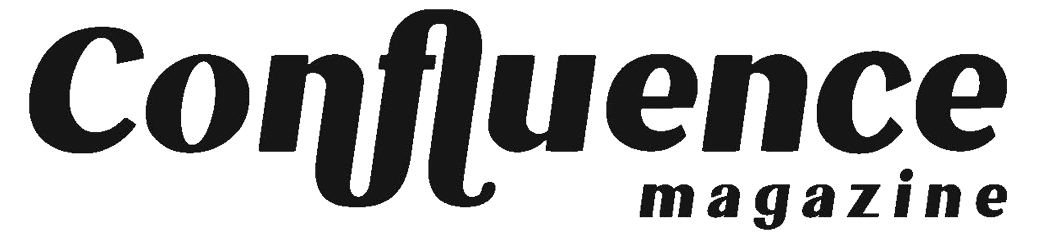P. Geoffrey Bakken
Le développement des sciences sociales modernes est intimement lié à la croyance des Lumières selon laquelle l’investigation scientifique peut être utilisée pour perfectionner la société humaine. Au milieu du XIXe siècle, Auguste Comte affirmait que la société avait évolué vers une phase scientifique dans laquelle les problèmes sociaux pouvaient être résolus par le biais d’une analyse raisonnée. Karl Marx, autre père de la sociologie, proposa une analyse extrêmement influente et consciemment scientifique du capitalisme et de l’inévitabilité subséquente du communisme, qui permettrait d’éradiquer la pauvreté et l’inégalité. Dans la lignée de la tradition des Lumières, des disciplines comme la sociologie, l’économie et les sciences politiques se sont intéressées, au cours des dernières décennies, à l’amélioration de problèmes sociaux dévastateurs tels que l’inégalité, le sous-développement, la dégradation de l’environnement, l’oppression et les conflits violents.
Pourtant, malgré toute l’attention portée par les observateurs universitaires, les activistes et les décideurs politiques, les progrès réalisés pour remédier à ces problèmes sociaux encore endémiques ont été limités, inégaux et bien trop réversibles. Pourquoi les efforts d’une armée de chercheurs en sciences sociales travaillant depuis plusieurs générations n’ont-ils pas permis de réaliser des progrès plus tangibles dans la lutte contre nos problèmes sociaux les plus urgents ? Dans cet essai, je soutiens que l’absence d’une conception cohérente de la nature humaine a contribué aux résultats frustrants de nos tentatives de faire progresser la société humaine par le biais de la recherche scientifique. Je suggère qu’une meilleure compréhension de l’esprit humain pourrait contribuer au projet global d’amélioration de la condition humaine qui unit toutes les sciences sociales.
De manière générale et en simplifiant énormément (comme l’espace limité l’exige), deux méta-paradigmes concernant la nature humaine ont guidé une grande partie de la recherche en sciences sociales au cours des dernières décennies. D’une part, il y a le paradigme rationaliste qui théorise les êtres humains comme des égoïstes poursuivant rationnellement leur intérêt personnel. Cette conception de la nature humaine constitue le fondement de la discipline d’économie et s’impose de plus en plus dans les sciences politiques. En soulignant que les actions suivent une « logique des conséquences » dans laquelle les décisions sont basées sur la façon dont les résultats attendus affecteront l’utilité d’un individu, le paradigme rationaliste ne considère pas la moralité comme une dimension inhérente à l’action humaine. Dans ce cadre, les gens sont décrits comme largement amoraux, ne prenant des mesures normativement correctes que si cela leur est personnellement bénéfique ou s’ils tirent une utilité inhabituellement élevée d’un comportement vertueux en raison d’idiosyncrasies de caractère.
En science politique, les hypothèses qui sous-tendent le paradigme rationaliste conduisent à une vision plutôt pessimiste de la probabilité de parvenir à des résultats moralement acceptables. Par exemple, il n’y a aucune raison de croire qu’un dictateur cessera de recourir à la violence contre ses propres citoyens simplement parce que la communauté internationale lui fait comprendre que c’est la bonne chose à faire ; au contraire, ce comportement se poursuivra jusqu’à ce que la structure d’incitation du dirigeant change, rendant la répression politique trop coûteuse pour être maintenue. Toutefois, le fait de considérer les gens comme des acteurs rationnels n’implique pas nécessairement une perspective aussi sombre. En économie, par exemple, il semble y avoir une foi presque axiomatique dans le principe d’Adam Smith selon laquelle la poursuite rationnelle de l’intérêt personnel profite à l’ensemble de la collectivité.
Contrairement à l’approche rationaliste, il existe un paradigme normatif qui conçoit les êtres humains comme étant principalement préoccupés par l’alignement de leurs actions sur des normes d’adéquation à des rôles et des identités particuliers dans différentes situations sociales. Alors que le paradigme rationaliste se développe en économie et en sciences politiques, le paradigme normatif est le plus répandu en sociologie. Dans cette perspective, les gens se préoccupent moins de faire tout ce qu’il faut pour atteindre leurs objectifs que de déterminer quelles actions sont prescrites dans des circonstances données et de se comporter en conséquence. Ainsi, les acteurs font ce qui est perçu comme juste pour lui-même, en opérant selon une « logique de pertinence » plutôt que selon une « logique des conséquences ». Contrairement aux égoïstes amoraux qui peuplent les modèles rationalistes du monde, les acteurs humains du paradigme normatif sont conçus comme des êtres fondamentalement moraux, profondément influencés par ce que leurs communautés considèrent comme juste et approprié.
Tout en reconnaissant la possibilité d’un écart entre les normes de comportement approprié et la capacité à adhérer à ces normes dans la pratique, le paradigme normatif tend vers une estimation optimiste de la possibilité d’atteindre des résultats moralement souhaitables. Les comportements problématiques peuvent être corrigés par la persuasion morale basée sur des normes clairement articulées, sans nécessairement faire appel à l’intérêt personnel des acteurs déviants, comme dans le paradigme rationaliste. Par exemple, les institutions internationales favorables à la démocratie pourraient être en mesure de socialiser les fonctionnaires des pays autoritaires afin qu’ils apprécient la démocratie pour elle-même, transcendant ainsi leur tendance rationnelle à perpétuer des arrangements oppressifs.
Comment concilier ces visions profondément disparates de l’humanité en analysant les problèmes sociaux et en tentant d’y remédier ? Beaucoup reconnaissent que l’action sociale peut suivre à la fois la « logique des conséquences » rationaliste et la « logique de pertinence » normative, mais les théoriciens sociaux doivent encore construire un cadre cohérent qui puisse expliquer quand l’action peut suivre l’une ou l’autre logique. Beaucoup trop d’énergie a été dépensée dans des débats improductifs dans lesquels les analystes s’appuient sur des résultats empiriques limités pour affirmer la supériorité de leur approche préférée.
Certes, les deux paradigmes sont intuitivement plausibles et l’on peut facilement trouver des cas qui correspondent aux prédictions de chacun. Mais les deux approches sont incomplètes et incapables, à elles seules, de rendre compte de l’ensemble des comportements humains. Le paradigme rationaliste n’explique pas pourquoi les discours sur les normes et la moralité constituent une part si essentielle de l’expérience humaine quotidienne, tandis que l’approche normative ne parvient pas à rendre compte de l’omniprésence des comportements antisociaux et immoraux. Mais si nous ne sommes ni les sociopathes en quête d’eux-mêmes envisagés par le paradigme rationaliste, ni les automates parfaitement socialisés imaginés par le paradigme normatif, alors qui sommes-nous ?
Je suggère que l’analyse scientifique sociales et l’élaboration des politiques pourraient être bien servies en s’appuyant sur des conceptions de la nature humaine qui dérivent plutôt de la sagesse héritée des traditions religieuses et moins des déductions abstraites des paradigmes théoriques contemporains. La perspective que je défends reprend un thème général des religions abrahamiques : la corruptibilité universelle de l’esprit humain, qui commence avec les transgressions des tout premiers êtres humains dans le récit du jardin d’Eden. En d’autres termes, je soutiens qu’il est utile, d’un point de vue analytique, de conceptualiser les êtres humains comme des pécheurs dans le cadre de la recherche en sciences sociales.
Avec cette caractérisation, je suggère que les gens sont très conscients et concernés par les prescriptions normatives des différents groupes sociaux auxquels ils appartiennent, et qu’ils agissent généralement pour maintenir et renforcer ces normes de comportement. Cependant, en tant que créatures faillibles, nous sommes la proie d’une série de défaillances spirituelles qui nous amènent à violer même nos codes moraux les plus sacrés. Une réflexion de bon sens sur l’histoire du comportement humain peut nous éclairer sur la manière dont s’exprime notre penchant pour le péché. Nous avons montré que nous ne tenons pas compte de la vie des autres dans la poursuite du profit et du pouvoir. Nous déshumanisons et opprimons ceux que nous percevons comme différents de nous. Nous nous installons confortablement dans des positions de richesse et d’influence, protégeant notre propre position contre des changements qui profiteraient au reste de la société. Nous ne pensons qu’à nos propres gains à court terme plutôt qu’à nos responsabilités à long terme envers ceux qui viendront après nous. Nous sommes indifférents à la souffrance des étrangers. Nous ne tenons pas nos promesses, nous mentons et nous agissons de manière hypocrite. Nous tenons pour acquis et blessons ceux que nous aimons.
Bien sûr, notre propension au péché ne signifie pas que nous sommes uniquement capables de dépravation. En effet, la plupart du temps, nous suivons les normes morales de nos communautés de manière irréfléchie et directe. Et nous sommes certainement capables d’une profonde compassion et d’une abnégation héroïque. Mais notre imperfection spirituelle signifie que nous avons tous le potentiel inhérent de nous écarter du droit chemin, en particulier dans des conditions extrêmes telles que la guerre, l’instabilité politique, la pauvreté et la dépression économique. Ce potentiel est universel et intemporel, et existe chez les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les traditionnels et les modernes, les éduqués et les analphabètes, les croyants et les sceptiques. La nature exacte de nos vices, et la mesure dans laquelle ils affectent d’autres personnes, peuvent varier en fonction de notre position sociale (les fautes d’un prince peuvent causer plus de dégâts que celles d’un pauvre), mais la corruptibilité est quelque chose que nous partageons tous.
Imaginer les êtres humains comme des pécheurs permet de donner un sens aux visions paradoxales de l’humanité offertes par les paradigmes rationaliste et normatif, tout en surmontant leurs limites. Cette perspective intègre l’idée du paradigme normatif selon laquelle les gens se soucient de respecter les normes de convenance de leur communauté, mais se débarrasse de l’attente naïve qu’ils se conformeront presque automatiquement à ces normes. Cette perspective accepte également le principe du paradigme rationaliste selon lequel les gens s’engagent souvent dans des actions aberrantes et intéressées. Cependant, alors que le paradigme rationaliste suggère que les gens recherchent leur propre satisfaction sans tenir compte des implications normatives de leur comportement, la vision des humains en tant que pécheurs reconnaît que les gens aspirent généralement à la décence, même s’ils sont parfois susceptibles d’être victimes d’un effondrement moral. S’écartant des hypothèses a priori sur l’inclination des gens à adopter un comportement normativement approprié, le paradigme spirituel que je propose part de la reconnaissance de notre capacité avérée à adopter un comportement à la fois honnête et immoral. Un programme de recherche en sciences sociales fondé sur une telle vision de l’humanité viserait à étudier les conditions sociales dans lesquelles les gens adoptent différents types de comportement – vertueux et vicieux – et à s’appuyer sur ces connaissances pour concevoir des politiques qui permettraient de mieux faire face aux problèmes sociaux les plus durables et les plus pernicieux.
Une compréhension inadéquate du caractère spirituel de l’humanité peut conduire à deux types de problèmes qui ont entravé les tentatives modernes de façonner nos sociétés pour le mieux. Premièrement, nous élaborons souvent des politiques qui reposent sur des hypothèses naïves concernant la nature humaine et qui ne pourraient fonctionner dans la pratique que si nous étions des saints plutôt que des pécheurs. Par exemple, une approche de la réglementation économique fondée sur le laissez-faire repose sur l’idée que le fait de laisser les gens poursuivre librement leur intérêt économique personnel permet à l’économie de prospérer. Mais cette position sous-estime la mesure dans laquelle les acteurs économiques, s’ils ne sont pas contrôlés, sont enclins à adopter un comportement cupide ou à courte vue qui peut nuire à la société dans son ensemble. La crise financière actuelle résulte du mauvais usage des instruments financiers à haut risque qui ont conduit les consommateurs à contracter des prêts hypothécaires qu’ils ne pouvaient pas se permettre et les entreprises à surinvestir dans des titres adossés à des créances hypothécaires douteuses. Ces politiques ont temporairement enrichi l’industrie financière et élargi les rangs des propriétaires, mais l’éclatement de la bulle immobilière a entraîné une épidémie de saisies, un krach boursier, un assèchement du crédit et une récession économique mondiale.
La politique d’éducation sexuelle fondée sur l’abstinence est un autre cas où la probabilité de la vertu est surestimée. Cette politique repose sur la retenue sexuelle des jeunes pour réduire le nombre de grossesses et d’infections sexuellement transmissibles chez les adolescents. Ces programmes se sont révélés inefficaces car ils ne tiennent pas compte de la difficulté de résister à la tentation d’adopter un comportement sexuel à risque, même pour les plus fervents défenseurs de l’abstinence. Ces exemples suggèrent que les politiques qui dépendent trop du bon comportement des personnes concernées ont tendance à ne pas être très efficaces.
Un deuxième problème découlant de notre compréhension insuffisante de la nature humaine est notre tendance à diviser le monde en catégories rigides de justes et de méchants, succombant souvent à l’hypothèse arrogante que Dieu est de notre côté. Plutôt que de reconnaître que nous sommes tous égaux dans notre potentiel d’échec moral, nous oublions notre propre péché, avec le résultat ironique que ceux qui sont le plus ostensiblement engagés dans le progrès social selon les principes des Lumières peuvent être coupables de l’inhumanité la plus brutale.
Les mouvements politiques idéalistes ont souvent illustré cette dynamique. La Révolution française, par exemple, a produit la Déclaration des droits de l’homme en 1789, proclamant que la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l’oppression étaient des droits naturels. Quelques années plus tard, le Comité de salut public de Robespierre a lancé un programme d’exécutions arbitraires pour protéger le gouvernement révolutionnaire de la menace perçue d’ennemis intérieurs, un blasphème absurde des principes fondateurs de la révolution. De même, l’avant-garde de la révolution bolchevique pensait mener le monde vers un avenir communiste qui éradiquerait les inégalités et créerait les conditions d’un épanouissement humain universel. Pourtant, ce projet s’est transformé en un État policier paranoïaque qui a emprisonné et exécuté des millions de koulaks, de cosaques et d’autres ennemis de classe au nom d’une révolution incontestablement juste.
En tant qu’observateurs occasionnels de l’histoire, nous avons tendance à attribuer ces atrocités au caractère exceptionnellement mauvais des personnages clés impliqués : Hitler, Staline, Pol Pot, Mao. Mais des horreurs telles que l’esclavage, le colonialisme, l’Holocauste, le génocide rwandais, le nettoyage ethnique dans les Balkans et la crise du Darfour ne sont pas simplement l’œuvre d’un seul dirigeant monstrueux ou de quelques pommes pourries. Ils nécessitent de nombreuses mains et découlent d’une capacité trop humaine à infliger du mal à autrui, à être envahi par la haine, à fermer les yeux sur la souffrance et l’injustice, bref, à être inhumain. L’envie de se dissocier de ces maux est puissante, car nous aimons nous considérer comme des gens bons, incapables d’une telle sauvagerie. Mais l’histoire de la souffrance humaine est l’histoire de personnes prétendument bonnes qui commettent des actes terribles les unes envers les autres. Nous devons donc accepter tout péché commis par une autre personne comme étant potentiellement l’un des nôtres.
Il est difficile, mais certainement pas impossible, de s’engager sur la voie de la droiture, que ce soit en tant qu’individus, en tant qu’entreprises ou en tant que nations. Pour concrétiser nos aspirations à des valeurs telles que l’égalité, la liberté et la paix, il faut non seulement des connaissances techniques, mais aussi une attention portée à la manière dont le caractère spirituel des êtres humains influence la mise en œuvre et l’efficacité des initiatives politiques. Lorsque nous reconnaissons les aspects les plus sombres de notre nature, la conception des politiques devient une question d’identification et de protection contre les sources de tentation auxquelles nous pouvons être confrontés.
La structure des institutions politiques américaines pourrait servir à illustrer une politique bien conçue à cet égard. Méfiants à l’égard de la concentration du pouvoir entre les mains d’une seule entité, les rédacteurs des institutions américaines ont réparti l’autorité entre trois branches distinctes du gouvernement. Bien que les membres de chaque branche se soient efforcés de renforcer leur propre pouvoir, la séparation des pouvoirs garantit une lutte permanente entre les branches exécutive, législative et judiciaire, le résultat étant qu’aucune branche ne peut accumuler une autorité absolue. Au lieu de faire confiance aux acteurs politiques pour qu’ils s’abstiennent de rechercher le pouvoir, les fondateurs ont anticipé la tentation d’étendre leur pouvoir et ont conçu des mécanismes pour contrôler cette tendance. C’est ainsi que le régime démocratique a survécu pendant plus de deux siècles.
Les sciences sociales modernes offrent un éventail impressionnant de techniques permettant d’acquérir des connaissances systématiques sur les sociétés humaines. Mais la connaissance scientifique ne conduira pas le monde sur la voie d’un progrès linéaire si elle n’est pas associée à une évaluation honnête et précise de la nature humaine. Se tourner avec humilité vers les connaissances de l’esprit humain offertes par les traditions religieuses est peut-être le meilleur moyen d’apprécier et de tempérer les lacunes que nous partageons depuis le début.