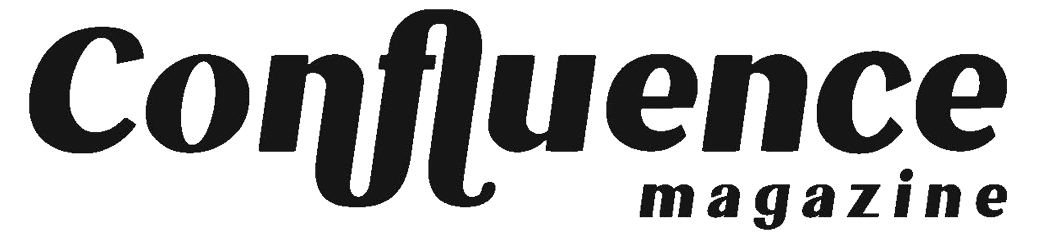Dr. Joseph J. Bright
Le désir d’explorer les secrets de la connaissance et de la cognition remonte à l’Antiquité. Les Égyptiens, au VIIe siècle avant JC, se demandaient quelle était la première langue et comment cette dernière était construite. Il a fallu cependant plus de deux mille ans pour que la psychologie se distingue de la philosophie. Les origines modernes du mouvement cognitif remontent à la fin du XIXe siècle, lorsque Wilhelm Wundt a ouvert son premier laboratoire à Leipzig, ou aux recherches approfondies menées par des chercheurs de Würzburg vers 1900 sur la manière dont les humains résolvent les problèmes.
Une approche plus systématique du langage et de la cognition a commencé dans les années 1920. Au cours des années 20 et 30, Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf affirmaient séparément que le langage était le facteur principal du processus constructif et qu’en fait, elle déterminait la pensée. Whorf a affirmé dans ses Collected Papers on Metalinguitics que le langage est le principal facteur d’objectivation de la réalité. Elle détermine la pensée et certains de ses aspects restreignent notre vision du monde. Une forme plus faible de « l’hypothèse du langage » n’insiste pas sur le fait que le langage détermine la pensée, mais sur le fait qu’il prédispose la façon dont les gens pensent.
Dans les années 50, lorsque le behaviorisme était à la mode intellectuelle, il n’y avait pas beaucoup d’études sur le langage et la cognition. Le modèle stimulus-réponse-renforcement privilégié par les comportementalistes a été appliqué à l’acquisition du langage par Skinner dans son livre Verbal Behaviour. Selon Skinner, le comportement verbal peut être acquis si l’ensemble des réponses appropriées est fréquemment suivi d’un renforcement. Le renforcement, affirme-t-il, est tout aussi important une fois la langue acquise. Le but et la fonction du renforcement sont de maintenir la force de la réponse. L’acquisition du langage et le comportement verbal sont considérés comme des processus mécaniques. Le comportement verbal ne peut se développer que dans un contexte social, avec la participation d’une autre personne ou d’un autre public. L’orateur n’apprend finalement à parler qu’en présence d’un auditeur ; le renforcement dont un locuteur a besoin est absent ou présent lorsqu’un auditeur est absent ou présent. Cette vision considère le langage comme un comportement d’apprentissage qui peut être modifié ou manipulé à l’aide d’un renforcement ou d’une privation, en d’autres termes « une condition de contrôle spécifique… le contrôle des stimuli verbaux ».
Skinner présente trois types de comportements différents qui contrôlent les stimuli verbaux : l’écho, le textuel et l’intraverbal. Un comportement « échoique » se produit lorsque la réponse consiste en un motif sonore reproduisant quelque chose de très similaire au stimulus. Il s’établit chez l’enfant grâce au renforcement particulier que Skinner appelle « éducatif ». Le renforcement éducatif est assuré par des institutions dont le comportement est influencé par le renforcement économique : par exemple, lorsqu’un enseignant reçoit une récompense financière (ou autre) pour avoir enseigné à l’enfant comment acquérir efficacement une langue. Le comportement « textuel » concerne l’apprentissage de la lecture. Cela aussi s’établit par le renforcement pédagogique. Le stimulus dans ce cas est un texte qui peut prendre la forme d’images, de pictogrammes formalisés, de caractères ou (plus communément) de lettres ou de symboles d’un alphabet. Le comportement « textuel » décrit la manière dont les gens acquièrent la compétence d’écrire. Le comportement d’écriture présente toutes les caractéristiques d’un comportement « échoique », mais exprimé en termes visuels plutôt qu’auditifs. Trois étapes sont distinguées : l’étape de production du matériel nécessaire, l’étape de réalisation des marques différenciées et l’étape de transmission de ces marques au lecteur.
Dans le cas du comportement intraverbal, il n’y a pas de correspondance entre le stimulus et la réponse produite, comme dans le comportement échogène ou comme dans la correspondance entre différents systèmes dimensionnels comme dans le comportement textuel. Cela permet de prendre en compte simultanément tous les types de stimuli et de réponses vocaux et textuels dans toutes les combinaisons. Il est intéressant de noter que Skinner considère la traduction comme un « cas particulier de comportement intraverbal ».
L’approche de la pensée de Skinner était abstraite et non empirique. Selon lui, les résultats de la pensée humaine peuvent être très imprévisibles et sont donc très difficiles à expliquer. Ainsi, la manière la plus simple et la plus satisfaisante d’expliquer la pensée est de la considérer comme un comportement. La pensée n’est pas un moyen secret d’influencer le comportement, mais elle est le comportement lui-même, la « somme totale » des réponses au monde et à l’environnement dans lequel le comportement « vit ». Il conclut : « Lorsque nous étudions la pensée humaine, nous étudions le comportement.’
Dans les années 60, le débat sur la langue se résumait en deux positions opposées. Les conceptions behavioristes du langage et de son acquisition en termes d’association, et l’approche de Chomsky et de ses collègues qui ont présenté une analyse linguistique fortement liée à la psychologie. Leur argument de base était que la théorie stimuli-réponse n’était absolument pas pertinente en ce qui concerne l’acquisition du langage. S’intéressant principalement aux formes syntaxiques du langage, ils pensaient que les structures profondes des phrases étaient abstraites et inexplicables par les arguments simplistes avancés par les behavioristes. Leur débat avec les comportementalistes et les articles théoriques dans lesquels ils critiquaient et mettaient en doute leurs points de vue n’ont pas laissé beaucoup de place à l’attention au développement de l’enfant et à la manière dont les processus de ce développement affectent leur acquisition du langage.
Piaget, bien qu’il ne soit pas psychologue de profession (il a débuté comme biologiste), s’est montré très intéressé par la façon dont les enfants pensent. Il croyait, contrairement à Sapir-Whorf, que la pensée détermine le langage, une position connue depuis sous le nom d’« hypothèse de la cognition ». La différence fondamentale entre les études de langues dans les années 60 et l’approche de Piaget était que Piaget s’intéressait aux enfants âgés de six ans et plus et étudiait le premier langage structuré pendant et peu après l’étape d’énonciation de deux mots. Il a discuté du langage et de la pensée de l’enfant, de la fonction du langage, des questions que posent les enfants et de la compréhension entre les enfants.
Piaget et Chomsky sont devenus les représentants les plus reconnus et respectés du mouvement cognitif ; leur travail a inspiré et influencé tellement de personnes et à tel point que l’on peut à juste titre parler d’une école de pensée dans le domaine des études cognitives. Chomsky avait des vues révolutionnaires et controversées sur le langage et sa pensée contrastait fortement avec tout ce qui l’avait précédé. Il a affirmé que chaque enfant possède un système de connaissances inné qui contient des structures linguistiques abstraites qui ne sont pas enseignées, mais qui font déjà partie du système de l’enfant dès sa naissance. Il a émis l’hypothèse que dans ces circonstances, il doit exister un ensemble de règles grammaticales qui produiraient des descriptions syntaxiques pour n’importe quelle phrase dans une langue donnée. Piaget, quant à lui, pensait qu’un enfant devait passer par plusieurs étapes pour acquérir un niveau de pensée logique adulte. L’effet de l’environnement sur la pensée et le langage d’un enfant est, pour Piaget, crucial.
La langue est un ensemble extrêmement large de capacités humaines. Des opérations mentales identiques sous-tendent les rencontres avec un large éventail de matériaux et de sujets tels que l’espace, le temps, les accidents et la moralité. Ainsi, les formes de pensée ultérieures peuvent être localisées dans des formes antérieures. Piaget a examiné l’enfant et son esprit en tant qu’agent actif et constructif, qui acquiert lentement des connaissances et une logique grâce au développement de processus cognitifs. Le point de vue de Chomsky était différent ; il considérait l’esprit comme un ensemble d’unités préprogrammées entièrement équipées, qui n’ont besoin que d’un modeste déclencheur de l’environnement pour fonctionner. En d’autres termes, Piaget considérait les capacités linguistiques humaines comme le produit d’un développement intellectuel général « construit », tandis que Chomsky insistait sur le fait qu’elles constituent une partie hautement spécialisée du patrimoine génétique humain, largement distincte de toute autre faculté humaine. Il s’agit, disait Chomsky, d’une sorte de connaissance innée qui ne demande qu’à se déployer. L’hypothèse cognitive piagétienne affirme que le langage dérive de la pensée. Chomsky adopte un point de vue radicalement différent, affirmant que le langage est séparé de la pensée. Il affirme que chaque faculté intellectuelle humaine est située dans différentes zones du cerveau et mûrit à son propre rythme et selon des processus distincts. Pour rendre cette affirmation plus compréhensible, Chomsky a utilisé l’analogie des organes humains : il considérait l’esprit comme un ensemble d’organes, comme le foie, les poumons ou le cœur. On n’apprend pas à un cœur à battre, mais il mûrit selon son propre calendrier génétique. Il en va de même pour le « langage » ainsi que pour d’autres « organes de l’esprit », qui sont programmés pour fonctionner au fil du temps selon un calendrier génétique.
Bien qu’ils aient tous deux utilisé et développé des modèles fournis par la biologie et la logique, ils ont montré un intérêt pour des types d’exemples et d’explications très différents. Piaget a tenté de donner une description riche des étapes par lesquelles passent les enfants pour atteindre un niveau de connaissance supérieur. Il a donc développé un vocabulaire technique élaboré, enraciné dans la biologie, et il a basé ses conclusions sur les erreurs que les enfants commettaient lorsqu’il leur proposait de résoudre ses célèbres énigmes difficiles. Sa capacité à donner des réponses convaincantes aux problèmes du développement des connaissances et son travail acharné dans la collecte et la synthèse d’une énorme quantité de données constituent sa grande contribution dans ce domaine.
La contribution de Chomsky n’est pas moins importante. Ce qui le différencie de Piaget, c’est qu’il ne se soucie pas de décrire les phénomènes comportementaux ; sa préoccupation était le développement de la science linguistique et la manière dont son approche et ses méthodes pourraient s’appliquer aux sciences sociales. Ses vues sur le langage en tant que partie d’un système inné et universel de connaissance et de langage sont les mêmes et ont eu une énorme influence, bien que ce soit une hypothèse impossible à prouver.
En octobre 1975, Jean Piaget et Noam Chomsky sont invités à exprimer leurs idées et à présenter leurs théories lors d’une réunion qui a lieu à l’abbaye de Royaumont en France. L’importance historique de ce « rendez-vous » a été soulignée par la communauté psychologique et linguistique du monde entier et même des scientifiques des domaines comportemental et empirique ont assisté à l’occasion. Piaget et Chomsky ont échangé leurs points de vue sur le langage et la cognition, mais, comme l’ont commenté les participants à la réunion de Royaumont, il n’y a pas eu de conclusion concertée, seulement une exploration des problèmes.
Il n’est pas tout à fait surprenant qu’aucune conclusion définitive n’ait été tirée lors de cette réunion. L’étude de la cognition n’est pas une étude empirique de données ou de faits donnés susceptibles d’être mesurés ou expérimentés quantitativement. Le sujet concerne la psychologie humaine, où différents points de vue, théories, méthodes et expériences sont utilisés, différentes écoles sont créées et plusieurs disciplines telles que l’anthologie, la biologie, la philosophie, etc. sont impliquées ensemble. Sans ignorer l’apport important d’écoles telles que le behaviorisme, la psychanalyse, etc., seul le développement ultérieur du mouvement cognitif semble susceptible d’apporter des réponses satisfaisantes aux questions qui se posent quotidiennement à propos du langage et de la pensée. Le charme de l’incertitude suscitera la passion pour de nouvelles recherches qui mèneront de la simple confusion à une nouvelle théorie, un nouvel argument d’évaluation ou de débat.
Lecture utile
- Appel, M, H. (1977) Topics in Cognitive Development.
- Drorni, E. (1993) Language and Cognition: A Developmental Perspective.
- Massimo, P. (1979) Language and Learning.
- Skinner, B. (1957) Verbal Behaviour.
- Vasniadou, S. (1993) Language and Thought.
- Vhorf B.L. (1952) Collected Papers on Metalinguitics.