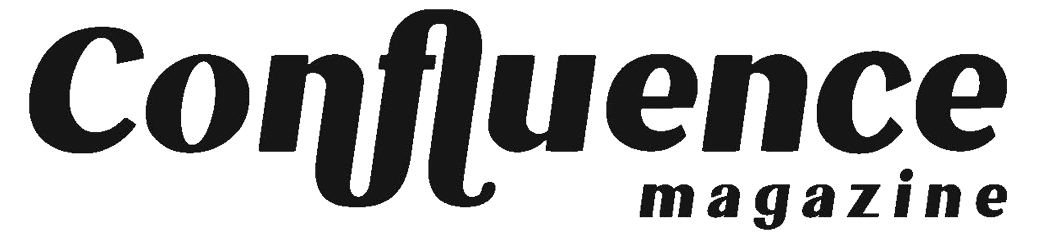Fred McIlmoyle
Dans toutes les cultures, à chaque étape de l’histoire depuis la nuit des temps, les individus ont été confrontés aux questions suivantes : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Comment puis-je contribuer à la société ?
Dans cet article
- Je me suis senti par la suite justifié dans ma décision de changer de cap en découvrant que les origines illustres de cette recherche intemporelle et universelle de la connaissance de soi étaient mises en évidence dans l’avertissement : « Connais-toi toi-même ».
- Les soi-disant « médias sociaux » sont tout sauf sociaux, jugeant souvent les individus selon leurs propres stéréotypes superficiels et sectaires, et attaquant verbalement ceux qui sont considérés comme n’ayant pas respecté leurs normes déformées.
- La société actuelle est plus prospère qu’à toute autre époque de l’histoire. Cependant, il serait erroné d’assimiler prospérité économique et paix, voire satisfaction sociale.
Dans chaque culture, à toutes les étapes de l’histoire depuis la nuit des temps, les individus ont été confrontés aux questions suivantes : Qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Comment puis-je contribuer à la société ?
Ces questions ont occupé mon esprit, jeune homme, il y a plus de quarante ans, assis dans la salle d’attente d’un dentiste, l’attention rivée sur un article de magazine consacré à l’anomie [1], un concept sociologique développé par Émile Durkheim.
Durkheim décrivait cet état comme une rupture du cadre normal de nos vies ; le bouleversement des règles et des attentes, et une perte du sens de notre place dans la société et de notre statut social par rapport aux autres. Durkheim observait que ce trouble survenait principalement dans les villes de la société industrielle, en période de mutations sociales rapides, tant ascendantes que descendantes. Il semblait engendrer de graves problèmes psychologiques et sociologiques chez ceux qui subissaient ses effets démoralisants.
La lecture de cet article passionnant m’a poussé à réévaluer le cours de ma vie. J’étais déterminé à en apprendre davantage sur les problèmes urgents auxquels la société industrielle contemporaine était confrontée, à me positionner pour mieux les comprendre et, peut-être, à contribuer à la lutte contre leurs conséquences sociales perturbatrices.
Suite à cette révélation, je n’arrivais plus à me réhabituer à ce que je considérais désormais comme un rôle administratif monotone. Quelques mois plus tard, j’ai quitté mon emploi et me suis inscrit, comme étudiant adulte, à un cursus universitaire en sciences sociales, avec une spécialisation en sociologie. Plus étrange encore, moi, presbytérien « rusé », j’avais été détourné du droit chemin par un groupe de philosophes, de sociologues et de psychologues et je remettais désormais en question la nature essentielle de l’homme, sa place dans la société et mon rôle dans la compréhension de son évolution.
Cependant, j’ai ensuite senti que ma décision de changer de vie était justifiée en découvrant que les origines illustres de cette quête intemporelle et universelle de la connaissance de soi étaient illustrées par l’exhortation « Connais-toi toi-même », inscrite sur le pronaos du temple d’Apollon à Delphes selon l’écrivain grec Pausanias. Cette phrase fut plus tard développée par Socrate, le philosophe qui enseignait qu’une vie sans examen ne valait pas la peine d’être vécue.
Peu après avoir commencé mes études, j’ai découvert une autre théorie sociale qui, à première vue, semblait diamétralement opposée, mais qui, après une étude plus approfondie, présentait de nombreuses similitudes avec celle d’Émile Durkheim. Il s’agissait du concept d’« aliénation » de Karl Marx. Il y cherchait à décrire la répression et le manque d’estime de soi subis par les individus soumis aux forces, aux exigences et à l’exploitation de la société industrielle. Marx pensait que cette aliénation se manifestait de plusieurs manières. Les individus étaient :
– Aliénés des produits de leur travail ;
– Aliénés de leur propre activité au sein du processus de travail ;
– Aliénés de leur « être générique » [2] ;
– Aliénés des autres.
La clé de sa conception était que les individus soumis à une ou plusieurs de ces formes d’aliénation ne pouvaient s’accomplir pleinement que par le développement de leur Être générique. Atteindre cet Être générique était donc essentiel à leur bien-être et à leur épanouissement.
Marx croyait que rien n’était intrinsèquement ancré dans la nature humaine. Si notre constitution biologique naturelle produit des appétits, des besoins et des penchants, ceux-ci sont façonnés par les facteurs historiques rencontrés quotidiennement. Les individus peuvent transcender leur situation par l’action et l’interaction sociale, transformant ainsi leur nature en celle d’êtres génériques accomplis. Les principaux obstacles à cet objectif résidaient dans les points un et deux ci-dessus : l’aliénation par rapport aux produits de leur travail et l’aliénation par rapport à leur propre activité spécifique au sein du processus de travail.
Marx croyait que l’être générique insatisfait ne pouvait être atteint que par la suppression des facteurs répressifs de la structure capitaliste existante. L’immense richesse créée par la division du travail n’était pas équitablement répartie en raison de la situation aliénée du travail. Un être générique pleinement développé compenserait ce déséquilibre, permettant l’expression d’expériences esthétiques, d’activités communautaires et de créativité intellectuelle.
Herbert Marcus, membre de l’école de la Théorie critique, était en désaccord avec Marx. Il considérait la société comme irrationnelle, estimant que sa capacité productive était entravée, et non facilitée, par l’émancipation des besoins humains. Il suggérait que les individus s’identifiaient si étroitement à leurs possessions matérielles qu’ils transformaient le monde objectif en une extension de leur propre être. Ainsi, l’existence que leur impose la rationalité technique constitue un stade encore plus progressif d’aliénation. Leur véritable conscience se fond et est engloutie par une fausse conscience unidimensionnelle qui imprègne toutes les sphères de leur vie sociale : « Le sujet aliéné est englouti par son existence aliénée. » Nous créons nos images, qui deviennent ensuite nos désirs. Ces désirs nous motivent et finissent même par nous obséder.
J’ai obtenu mon diplôme en sociologie avec mention, et j’ai réalisé ma thèse dans mon domaine d’études préféré : « Étude comparative du développement des théories de l’anomie et de l’aliénation ». C’était une orientation bien différente de celle de la plupart de mes collègues. Cependant, malgré de nombreuses tentatives pour obtenir un poste où je pourrais mettre à profit mes connaissances spécialisées récemment acquises pour contribuer à la résolution des problèmes connexes, je n’y suis pas parvenu et j’ai finalement été contraint de me réorienter vers un domaine où j’avais une expérience pertinente. Ma carrière s’est terminée dans l’ingénierie aéronautique, plus précisément dans le développement et la rédaction de procédures de fabrication pour la conception et la production d’avions et de missiles pour plusieurs grandes entreprises en tant qu’analyste principal des procédures commerciales. C’était très éloigné de ma vocation, qui était le domaine qui m’attirait le plus. Par conséquent, je n’ai pas pu contribuer aux efforts de progrès ni contribuer à une quelconque amélioration sociale.
C’est la première fois depuis quarante-trois ans que je « mets la plume sur le papier » en exposant quelques réflexions sur le développement original des concepts de ces sociologues et en appliquant leurs concepts à une analyse et une compréhension de la question de savoir si et comment l’anomie et l’aliénation exercent encore leur influence dans les conditions sociales contemporaines en constante évolution.
L’aliénation est devenue une expression presque banale et courante, perdant une grande partie de la précision initiale que lui attribuait la définition et le développement de Marx. Si les problèmes soulevés par ces deux concepts ne diminuent pas dans la « nouvelle société technologique » d’aujourd’hui, ils restent plus répandus que jamais, modifiant simplement leur mode et leur orientation d’attaque dans un environnement technologique moderne. Bien que l’anomie n’ait jamais été aussi connue que l’aliénation, et l’est encore moins aujourd’hui, c’est sans doute celle qui semble s’être le plus efficacement insérée dans la société d’acquisition actuelle. La « maladie de l’aspiration infinie » de Durkheim et le problème de l’« égoïsme » ou de l’isolement social sont plus évidents aujourd’hui qu’à aucun autre moment du passé. Il me semble que les facteurs sociaux qui ont ravivé l’anomie continueront probablement de progresser techniquement et de poser problème à l’avenir. Les sociologues et les philosophes se débattent manifestement encore avec ces questions, alors que notre monde évolue encore plus rapidement en cette ère sociale post-métaphysique. Nos réponses doivent nécessairement continuer à s’adapter aux conditions historiques et technologiques auxquelles nous sommes confrontés, tant individuellement que collectivement. Les faits montrent que nous ne parvenons pas à accomplir avec brio ce qui constitue incontestablement une tâche colossale.
Cela peut paraître paradoxal, car la société actuelle est plus prospère qu’à n’importe quelle autre période de l’histoire du monde. Cependant, il serait erroné d’assimiler prospérité économique à la paix, voire au contentement social ; elle n’apporte pas non plus nécessairement un sentiment d’appartenance aux structures familiales traditionnelles. La famille nucléaire s’est érodée, remplacée par des familles monoparentales. Aujourd’hui, les enfants sont dispersés dans le monde entier, ce qui fragilise encore davantage les liens familiaux, alors que le rythme de développement de la société se poursuit sans relâche. Parallèlement, les questions de sexe et de genre ajoutent à la complexité des nouvelles décisions que les individus doivent prendre au quotidien au sein de la famille.
Un large groupe social, majoritairement jeune, se replie désormais sur lui-même dans des « cocons » mobiles ou des cellules Internet, se coupant du reste de la société. Les soi-disant « médias sociaux » sont tout sauf sociaux, jugeant souvent les individus à l’aune de leurs stéréotypes sectaires et superficiels, et attaquant verbalement ceux qui ne répondent pas à leurs normes déformées. Insulaires, polarisants et antisociaux, ils n’apportent rien à nos efforts pour réaliser le véritable potentiel social de l’humanité : devenir des êtres socialisés, dotés d’un sentiment d’appartenance à une société bienveillante et réfléchie.

La citation du poète John Donne : « Nul n’est une île », certes un brin sexiste dans la terminologie moderne, est en totale contradiction avec la réalité de la société contemporaine. Des millions d’individus sont assis à « adorer » de petits écrans clignotants, inconscients du temps ; des êtres ensevelis, isolés, errant dans des mondes fictifs. Ce sont assurément des « insulaires » et il est peu probable qu’ils reviennent à leur mode de vie antérieur.
Dans la société médiévale, les gens se considéraient comme faisant partie intégrante de la nature. Ils étaient liés par le système féodal et l’Église. La majeure partie de la production du pays reposait sur l’agriculture et la population rurale était peu encline au progrès. Une production alimentaire adéquate assurait le bien-être, ou du moins la survie, de tous les travailleurs agricoles.
Ceci, cependant, ne devait pas durer.
Le pouvoir des guildes et le rôle du commerce, s’intensifiant avec l’essor de la révolution industrielle, conduisirent à l’émergence du capitalisme et affaiblirent l’influence de l’Église.
S’ensuivit immédiatement une instabilité croissante suite à la dissolution du système féodal. Deux nouveaux facteurs – les marchés de masse et la concurrence – sans limites et menaçante – favorisèrent une plus grande liberté pour tous et l’indépendance des ambitieux. De nombreux grands propriétaires terriens se laissèrent emporter par les progrès technologiques – coton, charbon, canaux et chemins de fer – au détriment de l’agriculture. Pour la plupart des travailleurs les moins qualifiés, cela représentait un sentiment d’incertitude, de menaces et souvent de dénuement.
Revenant à la théorie de l’anomie d’Émile Durkheim, qui croyait que la nature individuelle d’un individu reflétait la structure sociale de la société dans laquelle il vivait, avec toutes ses tensions. Il soulignait la nécessité d’une régulation sociale et morale pour protéger les individus des effets destructeurs des rapides changements économiques, sociologiques et structurels. Il continuait à affirmer la nécessité d’appartenir à des groupes sociaux pour prévenir les effets de l’égoïsme (isolement ou détachement social) conduisant au désespoir et à l’aliénation, voire au suicide.
Il est devenu évident que même les bénéficiaires de cet environnement de croissance souffraient de ce que Durkheim appelait « la maladie de l’aspiration infinie » : une quête incessante de réussite, sans limites d’attentes et sans sentiment d’accomplissement après une réussite.
Eric Fromm, un autre sociologue analysant le même problème, a fondé sa critique de la société industrielle sur la technique de la « psychanalyse humaniste », identifiant deux types de besoins individuels :
– Premièrement, les besoins physiologiques (comme la faim).
– Secondement, les aspirations humaines ancrées dans la nature particulière de l’existence.
Il considérait ces besoins fondamentaux comme essentiels pour préserver un état mental sain et vivre pleinement la nature et la société, à l’image de l’être générique de Marx.
Comme Durkheim, il estime que la société moderne ne permet plus aux individus de participer aux anciennes fonctions de « clan » ou de culte religieux, créant ainsi un sentiment d’anxiété et d’isolement qui n’existait pas auparavant. La liberté de vivre sans n’a pas été remplacée par la liberté de vivre pour parvenir à un mode de vie positif et épanouissant.
Conclusion
Quelle pourrait alors être la solution, selon ces sociologues, pour aider l’individu d’aujourd’hui à faire face à cette perte d’identité désastreuse, liée à la transformation de l’anomie et de l’aliénation par de nouveaux facteurs créés au sein du monde technologique moderne ?
Si la tendance actuelle se poursuit, Fromm envisage plusieurs alternatives possibles, dont aucune ne semble particulièrement attrayante :
– La Guerre nucléaire – la destruction de la civilisation et retour subséquent à un mode de vie agraire primitif pour les survivants.
– Robotisation résultant de l’automatisation croissante et continue, et de l’aliénation et de l’anomie qui en découlent.
– Sa dernière solution, la seule positive, est que nous assumions la responsabilité de la vie de TOUS.
Premièrement, il faudrait éliminer la menace constante de guerre par la coopération internationale et la redistribution de la richesse mondiale, les ressources étant placées sous l’administration d’un gouvernement mondial. Les actions devraient être menées sur une base de cogestion et ramenées à des proportions humaines. Ces initiatives exigeraient un consensus total et une mise en œuvre simultanée dans les domaines économique, politique, juridique et culturel.
C’est la conclusion d’Eric Fromm dans son livre « La société saine » (angL « The Sane Society »).
Je repense à la salle d’attente de ce dentiste d’il y a quarante ans avec stupéfaction et déception. Stupéfaction devant la vitesse à laquelle la technologie s’est développée et répandue. L’informatisation, les voyages à travers le monde, Internet et les téléphones portables se sont combinés pour réduire le monde à la taille d’un poing, « remplaçant » Dieu comme objet de dévotion. Le monde du travail manuel disparaît progressivement. Aujourd’hui, un monde automatisé ou robotisé, où tout se joue sur un bouton, produit des produits à une vitesse hallucinante, sans aucun lien entre le travailleur et son produit – comme l’avait prévu Marx.
L’intelligence artificielle (IA) est en marche !
Malgré notre richesse accrue, plus de la moitié de la population mondiale souffre de la faim, tandis que la production alimentaire est réduite pour gonfler les marges bénéficiaires. L’inflation galopante qui en résulte rend l’augmentation des revenus peu rentable dans le monde industrialisé.
Bien que nous ayons accru notre temps libre et jouissions d’une relative aisance, nous ne ressentons plus le sentiment d’épanouissement que nous connaissions lorsque notre temps était limité et que les loisirs étaient une denrée rare. Les fléaux sociaux que sont l’anomie et l’aliénation sont toujours chroniques, tandis que la « maladie de l’aspiration infinie » identifiée par Durkheim sévit dans notre société. Presque tous les jeunes aspirent à la célébrité (sans effort, bien sûr). Quinze minutes de célébrité ne suffisent plus.
Beaucoup de choses ont changé, mais si peu d’améliorations ont été observées sur le plan sociétal réel. Les analyses d’Émile Durkheim, de Karl Marx et d’Eric Fromm confirment mon point de vue. Tout véritable sentiment d’appartenance à cette société semble lointain, à moins que l’option finale de Fromm ne soit mise en œuvre – et bientôt !
Notes
– L’anomie désigne l’effondrement des cadres normatifs de nos vies, le bouleversement des règles, des attentes, de la perception de sa place dans la société et de son statut par rapport aux autres. Une condition sociale aux graves conséquences psychologiques, ressentie en période de mutations sociales rapides, ascendantes comme descendantes.
– « Être spécifique » suit l’initiation d’un processus de « Devenir » par lequel la nature se transcende et devient homme en interaction avec son contexte industriel. Ce processus doit se produire de manière dynamique et transformatrice, consumant ainsi son être spécifique et dépendant de la suppression des conditions de travail aliénantes existantes.
Bibliographie
- Durkheim, E. The Division of Labour in Society. Free Press. 1933.
- Fromm, E. The Sane Society. Routledge & Kegan Paul. 1963.
- Marcuse, H. One Dimensional Man. Routledge & Kegan Paul. 1964.
- Mezros, I. Marx’s Theory of Alienation. Merlin Press. 1970.