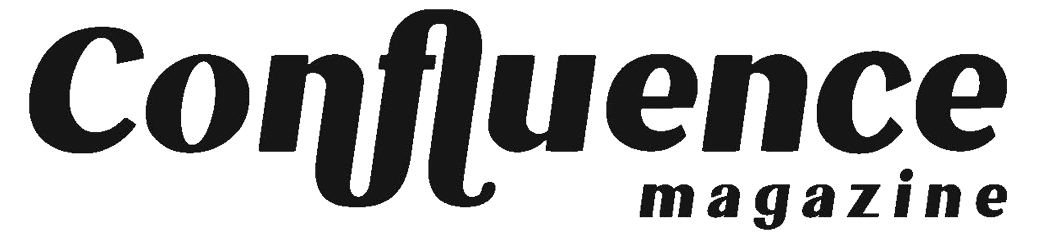Lawrence Brazier
Je suis bel et bien un immigré. Je suis britannique et j’ai épousé (et plutôt bien réussi) une Autrichienne. Nous vivons en Autriche depuis 36 ans. Il n’y a eu pratiquement aucune trace d’hostilité envers les étrangers (Ausländerfeindlichkeit) durant toutes ces années, pour la simple et bonne raison, je suppose, que je ressemble beaucoup à un Autrichien lambda. Je ne me distingue pas des autres et ma couleur de peau est identique à celle de tous les habitants du coin. Je passe donc le test, et si cette formulation paraît simpliste, voire brutale, je vous demande pardon. Je suis conscient depuis longtemps d’être un immigrant privilégié. La question de savoir si ce privilège est justifié ou non est ouverte.
Malheureusement, une personne dont l’apparence diffère de celle de la majorité d’un pays évoque souvent des idées et des notions d’étranger. Autrement dit, le sentiment d’appartenance à un groupe (nous) ou à un autre (les autres) est susceptible d’être instantané.
« L’herbe est toujours plus verte chez le voisin », et le mot « clôture » est aujourd’hui le mot clé. Cela dure depuis environ trois millions d’années. Au début, pour ainsi dire, l’humanité jouissait d’une planète sans frontières. Bon, peut-être que « jouissait » n’est pas le mot juste, car il n’existait aucun filet social pour protéger les gens des mauvaises journées. Mais avec l’explosion démographique, les barrières se sont dressées. Autrefois, peut-être plus agréable, la vie nomade consistait à vagabonder d’un pâturage à l’autre. C’était plutôt idyllique pour l’esprit, mais souvent délicat en réalité.
À notre époque troublée, l’immigration est forcée. Elle était souvent une question de choix. Dès leur apparition, les hommes vivaient dans un état de nature. Ils chassaient lorsqu’ils avaient faim, dormaient lorsqu’ils étaient fatigués, et lorsque la terre était dépourvue de fruits et de viande, ils partaient ailleurs, offrant à la terre une chance de se régénérer, de se reconstituer et de se renouveler. Ce déplacement, cependant, n’avait rien d’altruiste. Il s’agissait d’une simple quête d’herbe plus verte, d’un besoin naturel de survie et donc de la raison fondamentale de toute activité nomade.
La situation est bien plus complexe aujourd’hui. La plupart des immigrants sont des réfugiés et ont de la chance s’ils obtiennent le statut d’immigrant. Alors que des millions de réfugiés risquent leur vie pour trouver refuge loin des guerres qui ravagent leur pays, un sentiment de désarroi règne parmi les populations des pays d’accueil. Ce désarroi n’atteint pas les intellectuels qui nous dictent ce qui devrait être et le laissent tel quel. Naturellement, il y a suffisamment de nourriture pour tout le monde. La planète est un lieu d’abondance, mais nos efforts de gestion sont terriblement insuffisants pour distribuer ce qui pourrait facilement résoudre le dilemme de la pauvreté généralisée.
Ce qui complique encore les choses, c’est le prétendu manque de sophistication des immigrants (il faut toutefois noter que sans les jeunes femmes immigrées venues de Jamaïque et d’Irlande, les services hospitaliers britanniques s’effondreraient).
Les préjugés raciaux sont souvent profondément ancrés, surtout chez ceux qui luttent eux-mêmes pour maintenir un niveau de vie soi-disant « vivable ». Comment contrer les préjugés perçus en soi ? À cet égard, nous ne pouvons qu’espérer que nous nous rapprochons toujours plus de Dieu, de son dessein pour nous et de son amour. Nous sommes enfin hors de notre contrôle, et sous le sien. Bien sûr, aucune avancée, aucun changement réel, quels que soient nos efforts – et malheur à ceux qui renoncent à essayer – ne peut se réaliser par la pensée ou par les œuvres. Tout ce que l’on fait instinctivement, sans réfléchir, est probablement ce qui se rapproche le plus de la réalité spirituelle personnelle, jusqu’à présent. On s’excuse alors et on passe à autre chose.
Il faut dire que la personnalité inobservée peut être une bénédiction, mais aussi une révélation douloureuse. Néanmoins, quelle joie pour cet auteur de « se tromper » et, en même temps, d’avoir « raison » face au racisme ! Mon esprit logique me disait que la couleur de peau ne devait avoir aucune importance, mais je n’étais jamais vraiment sûr que la logique suffise à maintenir mon monde intérieur chancelant sur la bonne voie. J’étais sur le qui-vive, certes, je ne faisais jamais d’erreur consciente, mais je me demandais souvent (étant moi-même mon pire ennemi) si je n’en faisais pas trop. Puis Dieu, appelez-la la Vie si vous voulez, était bon.
Le racisme est une attitude tenace. Il peut être profondément ancré, voire inconscient, mais au final, la cause de toute appréhension humaine est très simple : la possession – autrement dit, l’argent – et c’est elle qui engendre l’anxiété. Il en a toujours été ainsi, le conflit entre Dieu et Mammon est notre lot depuis la chute de l’humanité. Ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, et le besoin de conserver ce que l’on a perdu, gouvernent nos attitudes. Il faudrait, évidemment, être un saint pour ne pas se soucier un tant soit peu de l’argent, surtout si l’on pense être sur le point de le perdre. Ironiquement, la transcendance au-delà des richesses matérielles, du moins dans le monde moderne, a été largement l’apanage de ceux qui étaient suffisamment riches pour pouvoir offrir des largesses.
Mon dictionnaire m’indique qu’un immigrant est une personne installée dans un pays dont elle n’est pas native depuis moins de dix ans. Ces nouveaux arrivants ont parfois une religion, une culture différente. Néanmoins, on pourrait considérer la culture ou la religion comme superficielles face au simple besoin de manger, de boire, de dormir et de se protéger des aléas, qui sont fondamentalement les raisons pour lesquelles les gens partent à la recherche de meilleures conditions ailleurs. L’angoisse profonde ressentie dans ce que nous appelons volontiers la condition humaine nous aide rarement à voir au-delà de ces besoins fondamentaux. On pourrait suggérer, par exemple, qu’une mère dont l’enfant est héroïnomane est susceptible de ressentir la même angoisse que n’importe quelle mère, quel que soit le pays et le contexte. Un homme au chômage, quelle que soit son origine ou sa religion, est susceptible de ressentir du désespoir.
Le désespoir peut pousser à la négation ou à la révolte. L’autodétermination est essentielle. Les pauvres – et les réfugiés et les immigrants le sont souvent – ont peu, voire pas d’autodétermination. Les classes populaires des pays développés manquent souvent aussi de tout sens viable de l’autodétermination, ce qui en fait évidemment des proies pour la droite politique. L’assimilation pour les immigrants implique souvent de s’adapter à une société qui n’est en aucun cas juste dans ses propres structures. Les immigrants de haut rang (neurochirurgiens, pilotes d’avion, et al.) ne seront tout simplement pas soumis aux contraintes et aux fardeaux des réfugiés plus ordinaires, qui luttent, aux côtés de la classe ouvrière d’un pays, pour des ressources limitées. Le problème est souvent celui d’un immigrant pauvre qui reflète la situation difficile d’un travailleur autochtone souvent en difficulté. On entend souvent de nombreux Américains de deuxième et troisième générations saluer les efforts de leurs parents, arrivés pauvres de leurs pays d’origine, en Europe et en Asie.
« Mon père cumulait trois emplois juste pour nous permettre d’aller à l’école. Ma mère s’est cousue les doigts pour gagner un peu d’argent. Tout ce que j’ai aujourd’hui m’a été donné par mes ancêtres immigrants. » Tels sont les mots des familles qui ont contribué au développement et à l’épanouissement de leur pays d’accueil.
Mais qu’en est-il de ma propre situation d’immigrant ? Comme je l’ai mentionné plus haut, j’ai atterri en douceur (mais sans une once d’allemand) avec une femme autrichienne qui m’a apporté une aide précieuse. Après avoir été licencié d’une douzaine d’emplois (les écrivains étant notoirement inemployables), nous étions devenus parents de quatre enfants. L’apprentissage de la langue s’est fait progressivement, ce qui, après quinze ans, nous a conduits à gérer notre propre agence de traduction. J’étais un immigrant assimilé qui avait connu une certaine réussite. L’important, c’est que je puisse désormais choisir où je souhaite vivre. Je ne suis pas confronté à la nécessité impérieuse de gagner beaucoup d’argent. La véritable bénédiction est venue lorsque nous avons emménagé dans une maison à la campagne. Le soulagement de la vie citadine était immense. Nous avons ralenti le rythme. L’important pour nous était l’instant présent. Les enfants mènent leur propre vie, même s’il y a généralement au moins un d’entre eux qui vient nous rendre visite à tout moment. Les habitudes et les difficultés du vaste monde extérieur ne nous conviennent pas. Nous ne lisons jamais les journaux, car les informations nous semblent si peu originales. Autrement dit, elles véhiculent la même horreur qui perdure depuis que l’humanité fait l’actualité.
Notre existence rurale semble se dérouler dans une sorte de confusion et de contentement. Il ne se passe pas grand-chose. Il n’y a pas de véritable centre-ville. Pas de commerces. Il y a bien sûr une église, une caserne de pompiers, un bar, une salle des fêtes et une unique cabine téléphonique, qui brille comme un objet étrange dans l’obscurité lorsque le village se couche. La cabine sert également d’arrêt de bus pendant la journée. Un bus scolaire, accessible aux adultes, part du village à 7 heures du matin. Deux bus arrivent au village pendant la journée, l’un à 13 h 30 et l’autre à 15 heures. On ne comprend pas pourquoi il y a un bus pour l’aller et deux pour le retour. Les villes de campagne les plus proches sont respectivement à cinq et dix kilomètres. Comme le bus sillonne les routes de campagne avec beaucoup de tangage, le chauffeur passe beaucoup de temps à tirer sur le volant, comme s’il ouvrait les portes d’une écluse.
On a beaucoup parlé quand Arnold, notre voisin fermier vivant seul, a coupé trois de ses arbres à la tronçonneuse. Les gens se sont arrêtés pour regarder. Malgré un coin enfoncé, l’un des arbres a lentement pivoté, grinçant sur sa souche avant de tomber dans la mauvaise direction. Il s’est écrasé en travers de la route au lieu de s’écraser dans le champ adjacent d’Arnold. Un ou deux hommes plus âgés ont souri d’un sourire secret, mais l’un d’eux a eu pitié et a crié : « Ne vous inquiétez pas, ça arrive aux meilleurs. » Arnold a grimacé, cachant désespérément son embarras et a hoché la tête en retour, soulagé, car ce sont des choses qui alimentent les conversations en milieu rural. Comme aucune route du village ne dépasse trois mètres de large, il n’a fallu que trois minutes pour couper des troncs d’arbres à des longueurs raisonnables et dégager la route. Les branches initialement coupées ont été emportées par quelques badauds qui ont jugé nécessaire d’intervenir.
Les choses ont commencé à se transformer en une occasion de se rassembler. La conversation a tourné autour de sujets comme « les arbres que j’ai connus », pour finalement aboutir à quelqu’un racontant l’histoire de l’homme motivé par ses instincts primitifs qui a abattu le mât de cocagne du village une année. Tout le monde savait qui l’avait fait ! Partout où il va, il affiche un sourire narquois, une amitié débordante, espérant être pardonné ou du moins compris.
En plein jour, les bruits du village proviennent principalement du passage des tracteurs. Les villageois reconnaissent généralement le bruit d’un tracteur avant même qu’il n’apparaisse. Le tracteur d’Arnold a peut-être 50 ans. Il est petit et son bruit est léger. Le pare-brise est fortement fissuré, ce qui est évidemment dû à une traversée en forêt et à la vue tardive d’une branche basse. J’adore la boue et la bouse de vache que les tracteurs laissent sur la route. Je regrette presque l’asphalte ; une bonne vieille ornière de chariot serait magnifique. J’ai envie d’une scène picturale à la Constable. Une charrette à foin serait formidable.
Mais je suppose qu’il est facile de nourrir des idées romantiques quand on n’a pas vraiment besoin de s’impliquer dans quoi que ce soit. C’est un privilège d’être plutôt âgé, d’avoir voyagé dans plus de 40 pays, d’avoir immigré pratiquement toute sa vie. J’ai eu de la chance. Je n’ai jamais possédé de voiture neuve et je n’en ai jamais eu envie. L’argent a souvent été rare, mais je dois dire que l’une de mes plus grandes bénédictions est de ne jamais me sentir pauvre.