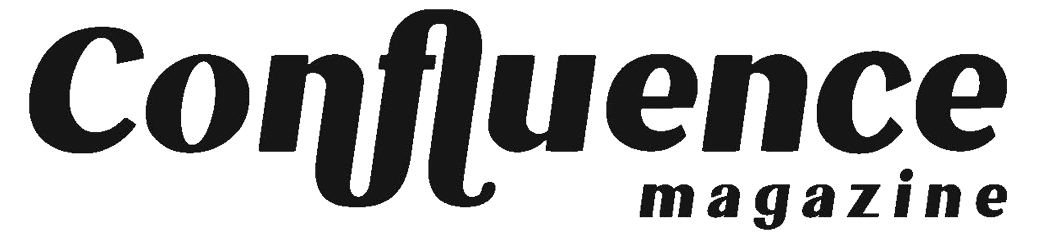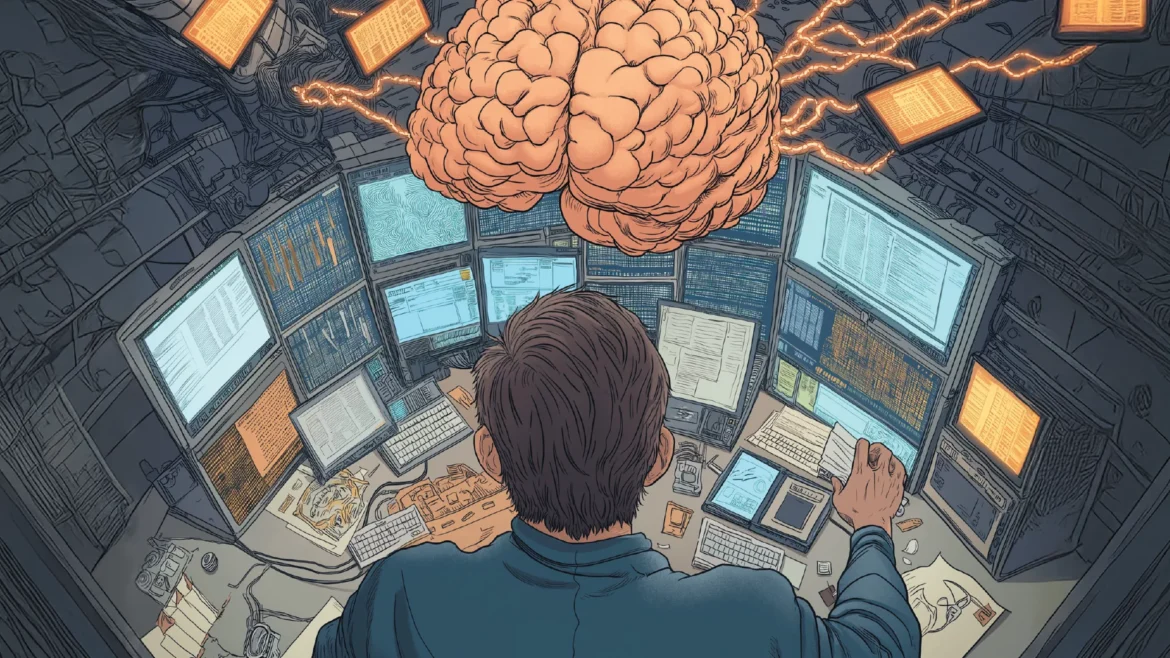Matt Alley
Le multitâche est-il vraiment possible ? Autrement dit, pouvons-nous facilement gérer plusieurs tâches et passer de l’une à l’autre sans sacrifier le temps et la précision ? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord comprendre le contrôle exécutif du cerveau sur les processus cognitifs.
Dans cet article
- Pouvons-nous facilement gérer plusieurs tâches et passer de l’une à l’autre sans sacrifier le temps et la précision ?
- Le multitâche, qui semble être un moyen d’efficacité à première vue, devient finalement plus chronophage et plus générateur d’erreurs.
Aujourd’hui, avec l’omniprésence des technologies, nous cherchons à être encore beaucoup plus efficaces au travail ou à l’école qu’avant. Nous essayons également de maximiser nos loisirs en nous adonnant à diverses formes de divertissement. Pour cela, la plupart d’entre nous pratiquent le multitâche (ou du moins prétendent le faire). En termes simples, le multitâche consiste à effectuer plusieurs tâches simultanément, comme écouter les informations tout en lisant un livre. Ce type de multitâche peut nous inspirer un sentiment de fierté, car il est généralement perçu comme un signe d’intelligence. Face à ce phénomène si populaire, la question lancinante est de savoir si le multitâche est réellement possible.
Naturellement, cet article évite les aspects hautement scientifiques de ce sujet neurologiquement complexe et vise à répondre à cette question pour le profane. Suivant cette approche, le terme « multitâche » est utilisé ici pour les tâches qui nécessitent une réflexion consciente. Par exemple, marcher et parler simultanément n’est pas considéré comme du multitâche, car la marche ne requiert pas de réflexion consciente ; elle est plutôt accomplie grâce à la « mémoire musculaire ». La définition exclut également les activités qui ne sont pas effectuées simultanément avec une autre activité, mais exclusivement à leur propre rythme au cours d’une journée, d’une semaine ou d’un mois. Par conséquent, diviser le temps d’une journée en plusieurs activités, comme passer une heure à lire, une autre heure à regarder la télévision, une autre encore à écrire, et éventuellement répéter chacune de ces tâches à son propre rythme au cours de la même journée, n’est pas considéré comme du multitâche.
Pour en revenir à notre question essentielle : le multitâche est-il vraiment possible ? Autrement dit, pouvons-nous facilement gérer plusieurs tâches et passer de l’une à l’autre sans sacrifier le temps et la précision ? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord comprendre le contrôle exécutif du cerveau sur les processus cognitifs. Ce contrôle exécutif peut être considéré comme la tour de contrôle qui orchestre les innombrables opérations cognitives variées du cerveau lors de l’exécution des tâches. Moralis et Dinan (2022) les répertorient comme incluant, sans s’y limiter, la planification, l’auto surveillance, l’accès à la mémoire de travail, la gestion du temps et l’organisation. Pour leur étude, Rubinstein, Meyer et Evans (2001) ont proposé un modèle théorique qui divise ces processus de contrôle en deux étapes principales impliquées dans le changement de tâche : le changement d’objectif et l’activation des règles.
Ils ont défini le changement d’objectif comme l’étape qui permet de suivre les tâches individuelles et d’informer les autres composants du système de la nature de la tâche en cours. Autrement dit, c’est l’étape où l’on se situe dans la séquence des tâches en cours, et où l’on lance, exécute et termine chaque tâche. L’étape d’activation des règles, qui suit le changement d’objectif, a été définie comme une réinitialisation de l’esprit, consistant à désactiver d’abord les règles de la tâche précédente, puis à activer celles de la nouvelle. Par exemple, si nous passons du tennis au basket-ball, les objectifs, les règles, les stratégies et bien d’autres choses doivent changer dans notre esprit. Les résultats de ces chercheurs, issus d’une série d’expériences, ont corroboré le modèle qui associe des étapes de changement d’objectif et d’activation des règles pour le changement de tâche. Si plusieurs facteurs, tels que la familiarité avec la tâche et la complexité des règles, ont influencé l’ampleur des coûts liés au changement de tâche, les résultats ont systématiquement montré que le changement de tâche avait toujours un prix à payer en termes de temps et de taux d’erreur.
Bien que le coût par changement soit relativement faible, il peut s’avérer considérable lorsque les utilisateurs alternent sans cesse entre les tâches. Par conséquent, le multitâche, qui semble être un moyen d’efficacité à première vue, devient finalement plus coûteux en temps et implique davantage d’erreurs (« Multitasking: Switching costs », 2006). Meyer, l’un des trois chercheurs mentionnés précédemment, déclare dans une interview sur leurs recherches : « Les personnes qui, au travail, tapent sur leur traitement de texte tout en répondant au téléphone et en parlant à leurs collègues ou à leur supérieur hiérarchique, changent constamment de tâche. Ne pas pouvoir se concentrer pendant, disons, des dizaines de minutes d’affilée peut coûter jusqu’à 20 à 40 % à une entreprise » (Anderson, 2001).
On trouve facilement de nombreuses études sur le multitâche, qui toutes démontrent son inefficacité. En effet, notre cerveau est programmé pour effectuer des tâches uniques plutôt que pour effectuer plusieurs tâches simultanément. Malgré sa structure remarquable et ses fonctions hautement sophistiquées, que nous commençons seulement à comprendre grâce aux progrès de la recherche sur le cerveau, le cerveau humain n’est curieusement pas conçu pour le multitâche. Autrement dit, on attend de nous que nous tirions le meilleur parti des expériences qui nécessitent une réflexion consciente plutôt que de chercher à devenir une machine efficace, capable de traiter l’information superficiellement et en très peu de temps. Cette conception n’est-elle pas parfaitement logique pour la seule espèce au monde capable de contempler et de donner un sens à l’existence dans son ensemble ? D’un autre point de vue, le multitâche a un impact considérable sur nos vies personnelles, sociales, professionnelles et éducatives. Il s’agit d’un autre sujet crucial qui mériterait un autre article.
Références
- Anderson, P. (2001, August 5). Study: Multitasking is counterproductive. CNN. http://edition.cnn.com/2001/CAREER/trends/08/05/multitasking.focus/
- Moralis, S. & Dinan, S. (2022, February 27). The myth of multitasking. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-therapeutic-perspective/202202/the-myth-multitasking
- Multitasking: Switching costs. (2006, March 20). American Psychological Association. Retrieved July 5, 2024, from https://www.apa.org/topics/research/multitasking#:~:text=Although%20switch%20costs%20may%20be,end%20and%20involve%20more%20error
- Rubinstein, J.S., Meyer, D.E., & Evans, J.E. (2001). Executive control of cognitive processes in task switching. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 27(4), 763-797. https://doi.org/10.1037/0096-1523.27.4.763