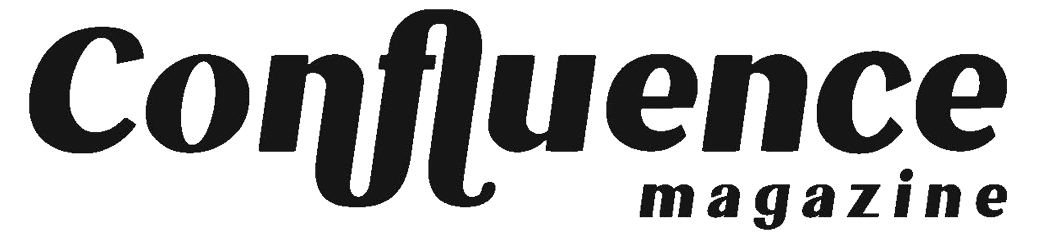Lyndsey Eksili
La parentalité et l’éducation jouent un rôle essentiel dans le développement de l’empathie. Enseigner l’intelligence émotionnelle, par exemple en aidant les enfants à reconnaître et à gérer leurs émotions, peut poser les bases de relations interpersonnelles saines.
Dans cet article
- En tant que société, nous avons le sentiment d’être à la croisée des chemins, contraints de choisir entre nous accrocher à notre compassion ou nous laisser aller à devenir de plus en plus durs et cruels.
- Une négativité prolongée affaiblit le système immunitaire, altère la mémoire et la concentration, et augmente le risque d’anxiété et de dépression.
- D’un côté, nous trouvons le chemin de la désensibilisation, où la cruauté devient une seconde nature et où la négativité domine notre esprit et notre corps. De l’autre, nous trouvons le chemin de l’humanité : un chemin de compassion, de compréhension et de positivité intentionnelle.
« Notre compassion humaine nous unit les uns aux autres, non par pitié ou condescendance, mais en tant qu’êtres humains ayant appris à transformer nos souffrances communes en espoir pour l’avenir. » – Nelson Mandela [1]
Consulter les réseaux sociaux fait désormais partie de notre quotidien, mais ces derniers temps, on le perçoit moins comme un lien avec le monde que comme une fenêtre sur une cruauté croissante. Le meurtre tragique de Brian Thompson, éminent PDG d’une compagnie d’assurance maladie [2] l’a douloureusement démontré. Alors que toute perte de vie devrait susciter une réflexion solennelle, la réaction a plutôt été marquée par une célébration inquiétante de la violence. Les réseaux sociaux ont été inondés de publications vantant cet acte comme une rébellion justifiée contre les failles perçues du système de santé. Cette réaction a non seulement privé Thompson de son humanité, mais a également réduit un problème sociétal complexe à un seul acte de violence. De telles réactions sont le symptôme d’une désensibilisation sociétale plus large, où les individus ne sont plus perçus comme des êtres humains, mais comme des symboles à attaquer ou à défendre. La capacité d’empathie et de deuil est de plus en plus remplacée par une culture toxique d’indignation et de justification, faisant de la cruauté la norme plutôt que l’exception.
Cette réaction inquiétante reflète un problème sociétal plus vaste. Des vidéos virales de violences urbaines à l’indifférence face aux guerres qui déplacent des millions de personnes, nous sommes constamment exposés à des images et des récits qui banalisent la cruauté. Une question se pose : quand sommes-nous devenus si insensibles ? À quel moment avons-nous cessé de voir l’humanité en chacun ? En tant que société, nous avons le sentiment d’être à la croisée des chemins, contraints de choisir entre nous accrocher à notre compassion ou nous laisser gagner par l’endurcissement et la cruauté.
Notre société actuelle est souvent décrite comme un monde VUCA [3], un terme initialement inventé par l’U.S. Army War College pour décrire les défis de l’après-Guerre froide. Cet acronyme signifie Volatilité, Incertitude, Complexité et Ambiguïté, et reflète la nature imprévisible, changeante et interconnectée de la vie moderne. Ces conditions ne génèrent pas seulement du stress et de l’anxiété au niveau personnel ; elles posent également les bases de la cruauté, de la désensibilisation et de la polarisation sociétales.
Par exemple, la volatilité de la vitesse de diffusion de l’information – souvent sensationnaliste ou décontextualisée – crée un environnement où les individus réagissent de manière impulsive, parfois avec cruauté ou jugement, plutôt qu’avec empathie ou compréhension. L’incertitude, comme celle qui entoure des problèmes systémiques comme les soins de santé ou l’instabilité économique, laisse les individus impuissants, les incitant à canaliser leur frustration vers l’extérieur, souvent vers des boucs émissaires. La complexité découle des systèmes interconnectés de notre ère numérique, où un seul événement peut déclencher l’indignation ou la déshumanisation à l’échelle mondiale, comme l’a montré la réaction en ligne au meurtre tragique d’un PDG. Enfin, l’ambiguïté rend difficile la distinction entre les faits et la désinformation, ce qui favorise les faux récits justifiants, voire célébrant, des actes de cruauté sous couvert de justice.
Ces conditions engendrent un stress et une anxiété accrus, conduisant souvent à des comportements défensifs ou réactionnaires. Le bombardement constant d’informations et la pression d’une adaptation rapide peuvent diminuer l’empathie et favoriser des environnements propices à la cruauté et à la négativité. Les réseaux sociaux amplifient ces effets en encourageant l’indignation et la division. Les publications provocatrices suscitent davantage d’engagement, créant des boucles de rétroaction qui normalisent la dureté. Dans un environnement aussi chaotique, la tendance à extérioriser les frustrations, souvent par des comportements méchants ou nuisibles, devient plus prononcée. Reconnaître l’influence de ce cadre VUCA est crucial pour comprendre pourquoi la société semble de plus en plus dure et polarisée.
La cruauté, cependant, commence souvent de manière subtile, comme un mécanisme de défense émotionnelle ou un exutoire à la frustration. Les psychologues expliquent qu’elle s’amplifie lorsque les individus éprouvent un sentiment d’impuissance ou de colère et expriment ces émotions vers l’extérieur, ciblant souvent ceux perçus comme moins puissants ou moralement coupables. Sur les réseaux sociaux, la cruauté prospère car l’anonymat diminue l’empathie. Une étude sur les effets sociaux et psychologiques de l’utilisation d’Internet [4] a révélé que les individus sont beaucoup moins enclins à prendre en compte l’impact émotionnel de leurs paroles dans des contextes en ligne anonymes.
Au fil du temps, la cruauté s’auto-alimente. Les interactions négatives libèrent de l’adrénaline et de la dopamine, créant un sentiment temporaire de pouvoir ou de satisfaction. Ce cycle de récompense peut rendre la cruauté addictive, car les individus recherchent une validation répétée par le biais de mentions « j’aime », de partages ou de l’approbation d’autrui. Si elle n’est pas maîtrisée, la cruauté s’intègre à une culture plus large, perpétuée par le biais de modèles sociaux et d’une désensibilisation collective.
Les effets de la négativité vont bien au-delà du préjudice émotionnel ; ils ont de profondes conséquences physiques et neurologiques. Lorsqu’on est exposé à du contenu négatif, que ce soit via les réseaux sociaux, les actualités ou les interactions interpersonnelles, notre cerveau active l’amygdale, la région responsable du traitement de la peur et du stress. Cela déclenche la libération d’hormones du stress comme le cortisol et l’adrénaline, bénéfiques par courtes périodes, mais nocives à long terme. Une négativité prolongée affaiblit le système immunitaire, altère la mémoire et la concentration, et augmente le risque d’anxiété et de dépression. Une étude de l’Université de Buffalo a révélé que les utilisateurs intensifs des réseaux sociaux signalaient des niveaux plus élevés d’inflammation chronique, comme l’indiquent des taux élevés de protéine C-réactive (CRP), liés à des maladies comme les maladies cardiaques et le diabète [5]. De plus, le cerveau se met en mode recherche de négativité, créant un cycle de stress constant et une résilience émotionnelle réduite.
Ces effets ne se limitent pas aux individus. Ils se répercutent sur les familles, les lieux de travail et les communautés, contribuant à une culture de stress accru et de bien-être émotionnel réduit. Pourtant, le cerveau humain est remarquablement adaptable. Tout comme il peut être conditionné à la négativité, il peut également être rééduqué à la compassion et à la positivité – un concept reconnu il y a des siècles. Zayd Al-Balkhi, érudit du IXe siècle et pionnier de la santé mentale, soulignait l’interdépendance des santés spirituelle, émotionnelle et physique. Il croyait que cultiver des habitudes positives pouvait revitaliser l’âme, contrer le déclin émotionnel et favoriser la résilience, bien avant que les neurosciences modernes ne confirment l’adaptabilité du cerveau [6].
Al-Balkhi recommandait des pratiques telles que s’entourer d’environnements stimulants, éviter l’exposition à la négativité et s’engager régulièrement dans une réflexion sur la gratitude. Par exemple, prendre le temps chaque jour de réfléchir aux bienfaits favorise un sentiment de joie et de contentement, tandis qu’équilibrer travail et repos contribue à maintenir la clarté mentale. La recherche moderne rejoint ces enseignements. À l’Université Duke, des chercheurs ont constaté que le fait de se remémorer quotidiennement trois expériences positives améliorait significativement l’humeur, réduisait le stress et améliorait le sommeil au fil du temps [7]. De même, une étude a révélé qu’une seule semaine d’exposition à du contenu positif pouvait accroître l’optimisme et réduire le stress. Ces résultats soulignent le pouvoir transformateur de la positivité intentionnelle [8].
Dr. Barbara Fredrickson, chercheuse de premier plan en psychologie positive, a démontré, grâce à sa théorie de l’élargissement et de la construction, que les émotions positives peuvent enrichir l’état d’esprit d’un individu, favorisant ainsi une plus grande résilience, créativité et empathie [9]. En pratiquant la gratitude, l’optimisme et la pleine conscience, les individus sont mieux armés pour aborder les autres avec compréhension et bienveillance. Cet effet d’entraînement va au-delà du bien-être personnel et influence la façon dont les communautés interagissent et relèvent les défis. En créant intentionnellement des environnements stimulants et en faisant preuve de compassion, les individus peuvent contrer la culture de la négativité et de la cruauté qui imprègne la société moderne. Dans un monde où la dureté domine souvent, de petits gestes positifs, nourris à la fois par la sagesse ancienne et la science moderne, peuvent collectivement reconstruire la compassion sociétale et encourager une évolution vers la bienveillance, tant dans les espaces personnels que publics.
En tant qu’adultes, nous avons la profonde responsabilité de donner l’exemple de la compassion et de l’empathie aux jeunes générations. Les enfants et les adolescents apprennent non seulement de nos paroles, mais aussi de nos actes. Lorsque nous nous livrons à des actes de cruauté en ligne, que nous parlons durement aux autres ou que nous manquons de bienveillance dans nos interactions, nous normalisons ces comportements à leurs yeux, leur envoyant le message que de tels actes sont acceptables. À l’inverse, lorsque nous faisons preuve de patience, de compréhension et de générosité, nous leur montrons que la bienveillance n’est pas une faiblesse, mais une force qui construit des relations enrichissantes et contribue à un monde meilleur.
La parentalité et l’éducation jouent un rôle essentiel dans le développement de l’empathie. Enseigner l’intelligence émotionnelle, par exemple en aidant les enfants à reconnaître et à gérer leurs émotions, peut jeter les bases de relations interpersonnelles saines. Les écoles peuvent mettre en place des programmes qui encouragent les discussions respectueuses, enseignent l’écoute active et offrent des possibilités de résolution collaborative des problèmes.
Montrer l’exemple du pardon, tant dans les relations personnelles que dans les conflits publics, démontre que la réconciliation n’est pas seulement possible, mais essentielle au bien-être émotionnel et sociétal. Au niveau sociétal, les dirigeants, les influenceurs et les institutions doivent promouvoir l’empathie et créer des espaces qui privilégient la compréhension plutôt que la division. Par exemple, les initiatives qui rassemblent des personnes de différents horizons culturels ou socioéconomiques peuvent contribuer à combler les fossés et à favoriser le respect mutuel. Les personnalités publiques, en particulier celles qui disposent d’une plateforme importante, ont une occasion unique de donner le ton en diffusant des messages de bienveillance et en faisant preuve de responsabilité lorsque des erreurs sont commises. Les institutions, des lieux de travail aux organismes communautaires, peuvent mettre en œuvre des politiques qui récompensent la collaboration et l’inclusion, favorisant ainsi des environnements où l’empathie prospère.
De plus, les médias et les entreprises technologiques ont une responsabilité importante dans l’élaboration du récit culturel. Les algorithmes qui privilégient l’indignation et la division pourraient au contraire être ajustés pour amplifier les interactions positives et le dialogue constructif. Les campagnes mettant en avant des histoires de compassion, de résilience et d’unité peuvent inciter les individus et les communautés à privilégier l’empathie à l’hostilité. Une étude du Greater Good Science Center de l’Université de Californie à Berkeley montre que l’exposition à des histoires encourageantes et à des actes de gentillesse augmente la probabilité que les individus adoptent eux-mêmes des comportements prosociaux, créant ainsi un effet d’entraînement positif [10].
En fin de compte, la responsabilité de cultiver la compassion s’étend à toutes les facettes de la société. Que nous soyons parents, éducateurs, dirigeants ou individus, nous devons reconnaître le pouvoir de nos actions pour façonner le monde dont les jeunes générations hériteront. En choisissant consciemment d’être un modèle d’empathie et de compréhension, nous pouvons inspirer la prochaine génération à bâtir une société plus bienveillante, plus connectée et plus compatissante.
Le Coran nous le rappelle magnifiquement : « Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi ». (Sourate Al-Qasas, 28 :77). Ce verset nous appelle à refléter la miséricorde et la bonté divines dans nos propres actions. En incarnant ces valeurs, nous pouvons favoriser une culture où l’empathie n’est pas seulement un idéal, mais une pratique quotidienne.
Nous sommes bel et bien à la croisée des chemins. D’un côté, le chemin de la désensibilisation, où la cruauté devient une seconde nature et où la négativité domine nos esprits et nos corps. De l’autre, le chemin de l’humanité : un chemin de compassion, de compréhension et de positivité intentionnelle.
Les choix que nous faisons aujourd’hui façonneront non seulement nos vies, mais aussi celles des générations futures. À une époque de plus en plus marquée par des changements rapides et l’incertitude, nos actions collectives ont le pouvoir de déterminer si la cruauté ou la compassion deviendra la norme culturelle dominante. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, renforce la valeur de l’empathie dans notre expérience humaine commune. Prendre le temps de réfléchir avant de réagir, que ce soit lors d’une discussion animée en ligne ou d’un conflit en face à face, démontre la force nécessaire pour privilégier la compréhension à la colère. Chaque décision d’amplifier la positivité plutôt que la négativité, comme le partage d’histoires encourageantes ou les mots d’encouragement, se répercute sur le tissu plus large des comportements sociétaux.
Répétés et appliqués avec constance, ces choix individuels transcendent les actes isolés et deviennent des habitudes. Ensemble, ces habitudes construisent une culture où la compassion n’est pas un choix occasionnel, mais un élément ancré dans le quotidien. Une telle culture favorise la résilience, l’unité et l’espoir, des qualités indispensables dans un monde divisé et désespéré. En choisissant la compassion aujourd’hui, nous posons les bases d’un avenir où la bienveillance ne sera pas perçue comme une exception, mais comme une attente ; un avenir où les générations futures considéreront ce moment comme un tournant vers une société plus empathique et humaine.
Notes
- http://www.mandela.gov.za/mandela_speeches/2000/001206_healing.htm
- https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2024/12/astonishing-level-dehumanization/681189/
- https://www.vuca-world.org/where-does-the-term-vuca-come-from/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4789623/
- https://www.buffalo.edu/news/releases/2022/01/022.html
- https://iamphome.org/abu-zayd-al-balkhis-sustenance-of-the-soul-the-cognitive-behavior-therapy-of-a-ninth-century-physician/
- https://dhwblog.dukehealth.org/reflect-on-three-good-things/
- https://ggsc.berkeley.edu/images/uploads/GGSC-JTF_White_Paper-Gratitude-FINAL.pdf
- https://positivepsychology.com/broaden-build-theory/#:~:text=What%20is%20Fredrickson’s%20Broaden%2Dand,their%20personal%20resources%20over%20time.
- https://ggsc.berkeley.edu/images/uploads/GGSC-JTF_White_Paper-Gratitude-FINAL.pdf
* Publié pour la première fois dans The Fountain, le 1 mars 2025.